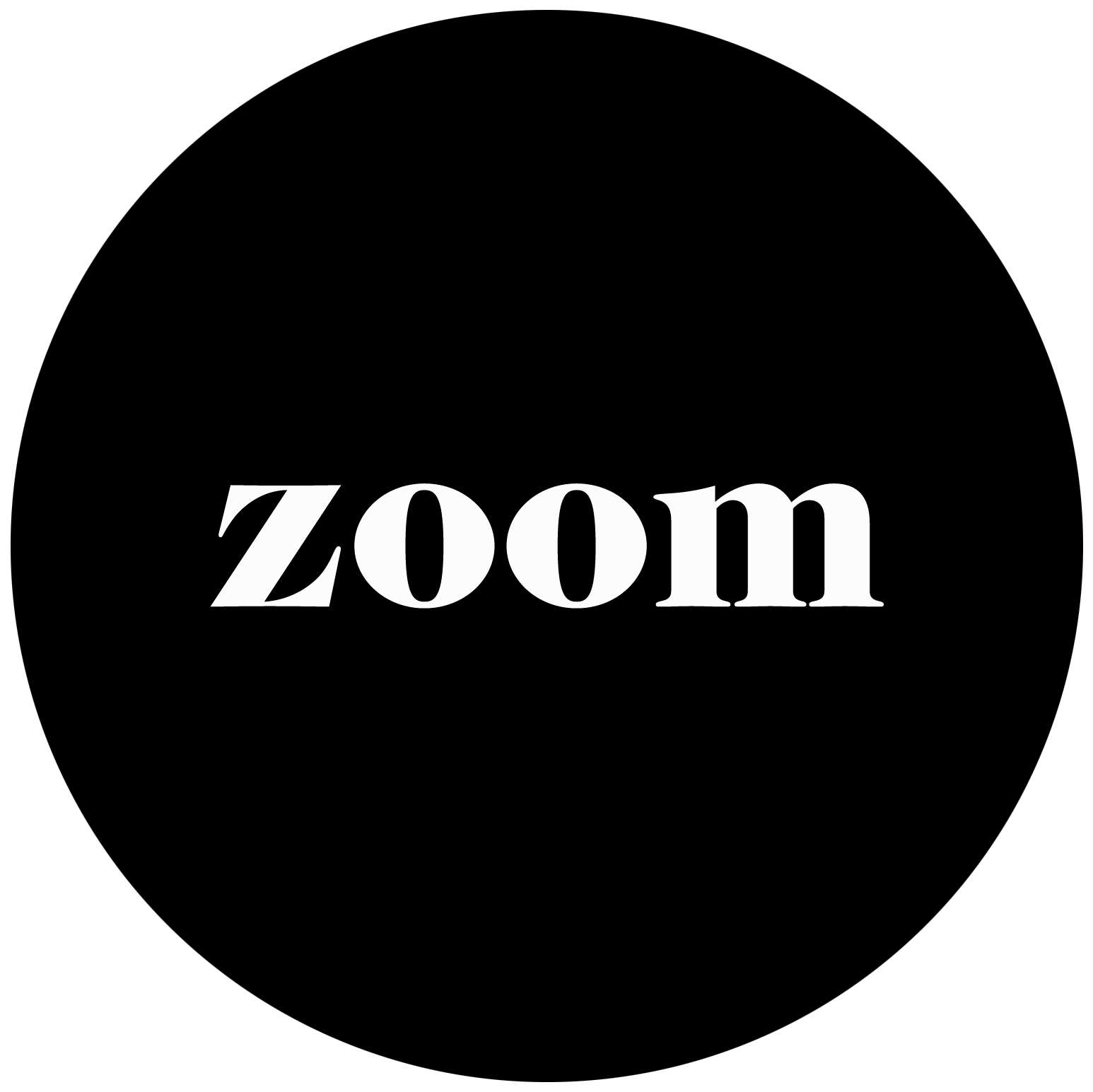
Le zoom de mars 2025 avec Reza
(Partie 2)L’Entretien,
Reza : ses débuts dans la photographie par Christine Delory-Momberger et Valentin BardawilRD. Ce sont véritablement ces six mois de torture et ces trois années de prison, il y a cinquante ans, que le régime du Shah m’a fait subir à cause de mes photographies, qui m’ont permis de comprendre à quel point la photographie était un langage universel qui avait un impact très fort sur le monde. Cette violence m’a aussi fait prendre conscience des conséquences que pouvaient avoir mon travail photographique sur ma vie. Alors après ma sortie de prison, je suis devenu beaucoup plus prudent, j’ai très peu communiqué avec les anciens prisonniers, il y avait cette peur de parler à quelqu’un qui appartiendrait au régime, surtout que je sais qu’en tant qu’ancien prisonnier politique, j’étais suivi et surveillé par
Mais ce séjour en prison a été aussi une période enrichissante car c’est à ce moment-là, grâce à mon intérêt pour les livres, que je découvre la langue française. J’avais eu l’idée qu’en prison, je pourrais prendre du temps pour lire, mais dans la bibliothèque de la prison il n’y avait que cent cinquante livres pour cinq mille prisonniers et une liste d’attente de deux mois pour pouvoir espérer obtenir un ouvrage qu’on ne pourrait emprunter que pour une heure seulement, même pas pour la journée. Le seul livre que personne n’empruntait était un ouvrage d’apprentissage de la langue française avec des photos. C’est donc en attendant ces deux mois terriblement longs pour obtenir le livre que j’avais commandé que j’ai commencé à apprendre le français avec un livre que j’avais pris en attendant.
VB. Quel genre de photos y avait-il dans ce livre que personne n’empruntait?
RD. C’étaient des photos d’illustration pour rendre vivant l’apprentissage du français. On pouvait voir des photos représentant un M. Legrand qui voyageait à Genève avec sa famille. Dans mon apprentissage du français que j’allais commencer grâce à ce livre, j’ai eu une autre chance incroyable car j’ai trouvé dans une unité de prisonniers voisine, un petit Larousse de mots français datant de 1900 qui avait sans doute appartenu à un ministre puisqu’il y avait son nom inscrit à la main derrière la couverture. Je ne sais pas comment ce dictionnaire était arrivé en prison mais c’est grâce à la phonétique qu’il y avait dedans que j’ai pu apprendre à prononcer le français.
VB. Donc, l’apprentissage du français arrive là-aussi par la photographie?
RD. Absolument et en découvrant ce livre, ce sont évidemment les photos qui m’ont interpellées avant le texte… Je me souviens de la première phrase qui était la plus difficile et que j’ai réussi à prononcer après quelques jours grâce au dictionnaire. Il y avait écrit : « Qu’est-ce que c’est ? », et en-dessous, il y avait la photo d’un crayon sous laquelle était inscrit : « C’est un crayon ».
Cet apprentissage de la langue française a été fondamental pour moi et m’a permis deux choses essentielles. La première arrive à la fin du régime du Shah, qui sous la pression du Président Carter accepte que des émissaires viennent visiter les prisons iraniennes. Cet émissaire qui arrive se prénommait Michel, il parlait anglais avec des traducteurs aux prisonniers sans la présence des gardes, ce qui nous avait tous étonnés. En nous rencontrant, il nous apprend qu’il vient de Genève, que sa langue est le français et que si l’un d’entre nous parle le français, il le prendrait bien comme interprète. Dans les rangs, personne ne bouge et moi non plus, mais d’un coup tous les prisonniers se tournent vers moi et me désignent en disant que je parle français. Ce Michel se tourne alors vers moi pour avoir confirmation, il faut imaginer que c’était la première fois en trois ans d’apprentissage que j’entendais parler le français et je lui réponds : « oui Monsieur, je parle le français ». C’est comme cela que je suis devenu son interprète auprès des prisonniers qui lui racontaient pourquoi ils étaient en prison et comment ils avaient été torturés, des choses que je ne savais même pas après trois ans de détention parce qu’évidemment on ne parlait pas de cela entre nous.
CDM. Après votre sortie vous avez gardé des contacts avec les anciens prisonniers?
RD. Oui, il y avait deux groupes en prison, ceux qu’on appelait les musulmans, ils étaient arrivés en prison à cause de leur revendication religieuse, et les autres, les prisonniers politiques qui rassemblaient les non-pratiquants, les artistes, les intellectuels qui étaient même parfois athées. La révolution contre le Shah était à la base, un grand mouvement populaire qui rassemblait tout le monde mais comme la gauche n’était pas organisée politiquement, les opposants se réunissaient dans les mosquées et là où les religieux se retrouvaient. C’est comme cela que ce mouvement populaire est passé entre les mains de la République Islamique, parce qu’ils avaient ces réseaux et ce relais sur le terrain.
Quand on était en prison, on était tous mélangés et les prisonniers politiques fréquentaient aussi les islamiques qui deviendront par la suite les ministres et les personnages du nouveau régime. Et comme on connaissait parmi eux, les traitres et les délateurs, ceux qui avaient travaillé en cachette pour l’ancien régime, leur premier acte, après leur prise de pouvoir, a été d’éliminer les anciens prisonniers politiques.
VB. Pour revenir à votre sortie de prison, que faites-vous après votre libération?
RD. J’ai repris mes études d’architecture et comme j’étais un ancien prisonnier politique et que cela procurait une certaine aura, j’ai eu une proposition d’embauche d’un des plus grands architectes iraniens qui avait fait des études en France, fondé l’université en Iran et qui était un homme de bien. Rentrer dans son cabinet était le rêve de tout le monde. D’autre part comme je savais que mon passage en prison avait eu des conséquences terribles sur une partie de ma famille, les collègues de travail de mon père par exemple avaient cessé de le voir du jour au lendemain, j’ai pris très au sérieux le travail dans ce cabinet.
VB. Malgré cela, vous avez quand même repris la photographie?
RD. Oui, dès ma sortie de prison mais quand il m’arrive d’être présent sur des photos, on se rend compte immédiatement que j’ai l’air absent, ailleurs… comme dans un autre monde…
VB. Vous ne craigniez pas que la reprise de la photo puisse vous causer à nouveau des problèmes?
RD. Je ne faisais que des photographies de famille. Rien de compromettant. Mais le cabinet d’architecture pour lequel je travaillais était situé sur une artère qui avait à peu près la taille du boulevard Saint-Germain et un après-midi vers 15h, on a entendu les bruits d’une manifestation contre le régime du Shah. On n’aurait jamais pensé pouvoir voir cela de notre vivant et sous nos fenêtres, on voit passer un groupe d’étudiants défiler contre le régime. Ce défilé effraie certains de mes collègues qui ne veulent même pas qu’on regarde par la fenêtre de peur de se faire repérer mais pour ma part, je suis heureux de voir ces manifestants passer et je m’installe à la fenêtre. C’est là que je vois des voitures de polices bloquer le cortège et commencer à tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Dans le groupe qui se met à courir, j’aperçois un étudiant, un appareil photo à la main qui photographie l’évènement et là, il se passe quelque chose dans ma tête et je commence à me mettre à sa place comme si je voyais exactement ce qu’il devait faire. Et même après que la manifestation ait été dispersée, je suis resté devant la fenêtre sans bouger, sous les yeux inquiets de mes collègues convaincus que j’étais choqué par ce que je venais de voir. Mais en fait, pendant trois heures, je me suis refait la scène en imaginant les photos que j’aurais faites si j’avais été à la place de cet étudiant photgraphe. Le soir, convaincu que les manifestions allaient continuer, je demande au directeur de l’agence de prendre quelques jours de repos pour aller sur le terrain. Mes employeurs ne sont pas très chauds à me laisser partir mais j’arrive quand même à leur arracher trois jours de repos.
La première chose que je fais en quittant le bureau est d’appeler mes amis de prison pour avoir des informations sur les prochains évènements en préparation. Malgré les peurs et les réticences de mes interlocuteurs qui n’étaient jamais certains de ne pas être trahis, parce qu’il y avait cette peur des dénonciations et des collaborateurs avec le système qui nous hantait tous, j’arrive à trouver les informations concernant la prochaine manifestation. Le lendemain, je suis sur le pied de guerre mais malheureusement dans les manifestations que je trouve, ni l’armée, ni la police n’interviennent et mes photos n’ont pas vraiment d’intérêt.
VB. Vous n’aviez pas peur de vous faire arrêter à nouveau et de repartir en prison?
RD. Il y avait une certaine insouciance chez moi et peut-être une sorte de vengeance à assouvir contre ce système que le peuple commençait à soutenir. Le troisième jour de manifestations, le bureau d’architecture m’appelle pour être certain que je serai bien de retour le lendemain mais je leur arrache encore quelques jours de repos. Ils m’attendent encore quarante-trois après…
Pendant les mois suivants, je vais suivre toutes les manifestations contre le régime et c’est durant cette période qu’une deuxième chose importante m’arrive grâce à mon apprentissage du français. Les manifestations contre Shah étaient populaires dans le monde et suivies par la presse internationale, et mon apprentissage du français va me permettre de rencontrer sur le terrain des photographes français comme Marc Riboud et Michel Setbon ou des journalistes de Libération ou du Nouvel Obs. Comme j’avais un réseau de relations très puissant grâce à mes relations de prison quand des gens comme Éric Rouleau, le responsable du Monde pour le Moyen Orient arrivait pour faire des interviews, c’était par moi que cela passait.
De mon côté, en tant que photographe, j’étais encore comme les amateurs avec mon petit appareil à la main en essayant de bien cadrer mes photographies mais en travaillant aux côtés de Marc Riboud ou Don McCulin, je découvrais qu’ils avaient trois appareils photo autour du cou et cinq objectifs dans leur sac, qu’ils faisaient plusieurs rouleaux en mitraillant la scène. Ces mois ont été pour moi un temps important d’apprentissage de la photographie mais aussi du photojournalisme.
C’est vraiment à ce commence-là que j’ai commencé à prendre conscience du fonctionnement du système, des médias et de la politique que j’ai rencontré les gens de l’Agence France Presse qui m’ont publié ma première photographie qui est parue dans tous les journaux. C’est à ce moment-là que je commence à avoir des amis français et même une petite amie française qui donnait des cours de français à Téhéran.
Grâce à la Révolution qui était en cours, j’avais récupéré mon passeport et je n’étais plus interdit de quitter le pays comme l’étaient jusque-là les prisonniers politiques. Je décide donc de suivre les conseils de mes nouveaux amis photographes et de venir à Paris rencontrer les agences françaises de photographie, même si une fois la Révolution passée je me disais que j’allais retourner à l’architecture. À peine arrivé à Paris, j’entends qu’il va y avoir une grosse manifestation de sidérurgistes et, après deux ans de Révolution iranienne, comme si je manquais de manifestations, je décide de couvrir cet évènement et là c’est une totale incompréhension, je vois des gens défiler en souriant et en chantant derrière des banderoles. Heureusement je commence à voir des gens courir et je décide d’aller voir ce que ces gens fuyaient, c’est comme cela que je me retrouve au cœur de la manifestation et au milieu des gaz lacrymogènes.
En Iran quand on se retrouvait dans cette situation la première chose qu’on faisait, c’était de bruler les papiers journaux parce que l’encre a une acidité qui enlève tout de suite l’effet des gaz lacrymogène, c’est comme cela que j’arrive à faire des photos du cœur de la manifestation que j’apporte trois jours plus tard à mon rendez-vous à l’Agence Sygma. Le numéro 2 de l’Agence me reçoit, les pieds levés sur son bureau, ce qui me perturbe, son geste était pour moi comme une insulte. Il regarde sans y prêter attention les photos de la manifestation que je venais de faire, en me disant qu’ils ont déjà Christine Spingler en Iran et que s’ils ont besoin de quelqu’un d’autre, ils feront appel à moi. Je me sentais vraiment insulté en sortant de ce rendez-vous et quand on me propose de m’organiser un autre rendez-vous à l’Agence Sipa avec Gökşin Sipahioğlu, j’hésite vraiment.
Mais cette fois-ci le rendez-vous se passe mieux et quand je montre à Göksin mes trois planches-contacts des images que j’avais faites durant la manifestation à Paris, il demande à tous les photographes présents dans l’agence de se présenter dans son bureau immédiatement. Je vois arriver six personnes de l’agence à qui ils montrent mes photos comme un exemple dont ils devraient s’inspirer. Quelques jours plus tard, alors que j’étais parti au Touquet invité par Pierre Blanchet du Nouvel Obs et Claire Brisset de Libération, je reçois un appel de l’agence de Gökşin qui veut m’envoyer au nom de l’Agence Sipa couvrir une demande de Paris Match à Téhéran.
Je commençais à profiter de la vie douce et du confort de la France avec ma petite amie mais dans la balance, l’idée d’être photoreporter à ce moment était plus importante. J’accepte la proposition et je repars en Iran avec un billet d’avion payé et 500 francs de frais en poche. Dans la manifestation en Iran qu’on m’avait demandé de couvrir, je vois qu’Abbas, Christine Spingler, Marc Riboud et deux autres photographes internationaux sont déjà sur place. J’avais emprunté un appareil à un copain pour remplir la demande qui était de faire du noir et blanc et de la couleur et je fais quatre rouleaux en noir et blanc et même pas un rouleau de couleur en entier mais je voyais tous les autres photographes courir partout et faire rouleau sur rouleau.
Le soir, lorsqu’on se retrouve à l’hôtel pour envoyer nos photos en France, la personne en charge de récupérer le matériel, en soupesant mon paquet qu’elle trouve un peu léger me demande pourquoi j’envoie aussi peu de rouleaux, je n’avais même pas mis la pellicule en couleur qui n’était pas finie. Mais je la donne quand même. Deux semaines après, je reçois un appel de félicitations de Göksin pour m’annoncer : « on avait eu six pages de publication dans Paris Match, quatre pages dans Stern, deux pages dans le Newsweek ». Personne d’autre que moi n’avait eu de photos publiées de cette manifestation. D’un seul coup tout bascule pour moi et je deviens officiellement photojournaliste. J’achète un nouvel appareil, mes photos commencent à circuler un peu partout et je deviens, en Iran, le contact officiel de tous les photographes étrangers qui vont et viennent en fonction de l’actualité. Je fais des diners, des soirées, je rencontre les plus grands photographes du monde entier. Sauf que même si je signais mes photo Reza qui était un prénom passe-partout en Iran aussi répandu que John aux Etats-Unis, la traque des anciens prisonniers politiques que le nouveau gouvernement islamique avait lancée commençait à se rapprocher de moi. C’est aussi à ce moment-là que j’ai décidé de couvrir un événement très important qui est la révolte des Kurdes contre l’État Islamique.
Comme il y avait des vrais combats entre l’État Islamique et les Kurdes, le gouvernement avait interdit l’entrée des journalistes dans la région occupée par les Kurdes. On savait que les villes étaient encerclées et bombardées mais personne n’était autorisé à couvrir les événements. Sauf que le chef de la résistance Kurde, Fouad Sultani, considéré comme l’ennemi numéro un par les autorités avait été en prison avec moi, je le connaissais très bien et je savais comment le joindre. Je lui envoie un message pour lui dire que je voulais venir le retrouver. Et comme il me connaissait et qu’il avait confiance en moi, il me fait rentrer clandestinement dans la ville assiégée. Je passe dix-sept jours avec lui sous les bombardements à photographier les horreurs de la guerre, les maisons bombardées, les familles détruites, les enfants qui meurent.
Mais à Téhéran comme plus personne n’avait de mes nouvelles, les gens pensaient que j’étais mort et c’est comme cela que l’Agence France Presse annonce que le photographe Reza est mort. En fait j’appliquais ce que j’avais appris en prison et je faisais exprès de n’appeler personne pour ne pas me faire repérer. Dix-sept jours après, alors que j’avais quasiment fini tous mes rouleaux de pellicules et que j’étais le seul témoin de toute ces horreurs, je sors de la région pour rejoindre une ville où je pouvais être en sécurité et appeler l’AFP. Après la surprise de me savoir vivant, ils me demandent de leurs envoyer les photos qui vont paraitre partout dans le monde. Ces photos vont faire un scandale international. C’est le premier coup médiatique que le Régime Islamique va prendre. Évidemment tout cela n’arrange pas mes affaires avec ces gens qui me recherchaient déjà comme ancien prisonnier politique mais ma tentative de déstabilisation du régime ne s’arrête pas là. J’avais vu à la une d’un journal iranien du Régime, une photo qui représentait une rangée de gens agenouillés aux yeux bandés qui étaient exécutés. C’était une photo inimaginable, très emblématique des horreurs que commettait à l’époque le Régime et la faire circuler était pour moi un acte politique de résistance.
En me renseignant je trouve la trace de cette photo et j’apprends que le rédacteur en chef du journal gardait toute une série de photos dans son coffre. Je trouve le contact avec la personne qui détenait la clé du coffre-fort du journal et en lui payant une somme conséquente, j’obtiens des tirages de cinq ou six photos assez marquantes que j’envoie à Paris en les prévenant bien, que je n’en étais pas l’auteur et qu’il ne fallait pas mettre de nom sur ces images. Quelques jours plus tard, ces photos paraissent dans la presse internationale. Paris Match fait même une double page en titrant : « L’exécution des Kurdes iraniens », on découvre même l’exécution d’un blessé sur un brancard. La parution de ces photos a fait un scandale mondial et elles sont même revenues en Iran pour provoquer d’énormes manifestations.
VB. Mais les gens ne les avaient pas vues lors de leur première parution?
RD. Non, elles avaient été publiées dans un journal qui avait un petite parution et Khomeini avait demandé qu’elles disparaissent, c’était pour cela qu’elles avaient atterries dans un coffre-fort. Cette histoire provoque un nouveau séisme dans le régime et je reçois l’appel d’un journaliste belge qui travaillait à Téhéran et qui recevait l’ensemble des journaux occidentaux pour me demander où je suis. Je lui réponds chez moi, là où tu m’appelles. Avec une voix tremblante, il me demande de venir tout de suite le rejoindre. Je fonce à l’AFP pour découvrir que Paris Match avait signé les photos du nom de Reza. J’appelle Paris et je comprends que c’est une rédactrice photo de Sipa qui connaissait mon travail sur le Kurdistan et qui avait pensé bien faire en mettant signant les photos de mon nom. En sortant de l’AFP, je décide de me cacher, Sipa prend un avocat pour démentir l’origine des photos mais le mal était fait. L’ambassade de France en Iran intervient même pour dire que le journal s’était trompé de nom mais c’est trop tard et je suis de toute façon déjà dans le collimateur du Régime. En plus, je fais une série d’images sur les otages américains les yeux bandés dans l’ambassade américaine de Téhéran. Je montre aussi comment deux étudiants islamiques sont en train de nettoyer le bureau de l’ambassade et en transportant les poubelles dans un drapeau américain. La photo est publiée dans Newsweek. Bref quand la guerre Iran-Irak arrive, le ministère de l’Information m’appelle pour m’interdire de quitter mon appartement avec un appareil photo.
Pour contourner l’interdiction, j’appelle un ami photographe iranien pour qu’il m’obtienne une accréditation du journal iranien pour lequel il travaillait et c’est comme cela que je pars sur le front suivre la guerre. Cette fois-ci, non pas au nom de la presse étrangère mais de la presse iranienne. Comme il était très difficile d’accéder au front, on trouve un hélicoptère qui accepte de nous déposer mais qui refuse de se poser. On devait sauter à un mètre du sol. À peine au sol, on court vers une tranchée pour rejoindre des soldats iraniens qui étaient à quelques mètres de nous, j’arrive complètement en sueur et alors que je suis en train de m’essuyer le front j’entends un obus tomber quasiment entre nous. On est tous projetés par la déflagration et en reprenant mes esprits j’entends des cris, des hurlements, je suis sonné mais je pense quand même à attraper mon appareil qui était autour de mon coup pour faire quelques photos et c’est là que je m’aperçois que du sang gicle de ma main. Une balle m’avait frappé. Comme je suis sous le choc et que je ne sens pas encore la douleur, je pense même à la photographier.
Autour de nous je découvre la violence de l’explosion, les corps déchiquetés. On nous emmène dans un hôpital militaire où on me bande la main mais je dois me faire ausculter sérieusement par un médecin et c’est seulement 48h après l’explosion que j’arrive enfin dans un hôpital dans lequel je me présente comme blessé de guerre. Mais là, c’est l’horreur je découvre dans les couloirs des rangées de brancards avec des corps déchiquetés. Comme je suis journaliste, j’arrive à avoir un rendez-vous et des radios, on découvre que j’ai trois éclats d’obus dans la main mais le médecin me dit qu’il n’a pas le temps ni les moyens de faire de la chirurgie et qu’il doit m’amputer la main ou à minima les doigts. Le soir dans ma chambre d’hôpital, complètement dévasté par la nouvelle, j’appelle un ami photographe pour qu’il vienne m’aider à m’échapper par la fenêtre pour avoir l’avis d’un groupe de médecins français qui travaillaient avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières qui étaient aussi présents dans la ville.
Je rencontre trois médecins français qui sont en mission humanitaire et qui me recommandent auprès d’un hôpital à Paris. C’est grâce à eux que je reçois une lettre de rendez-vous à Paris avec un chirurgien capable de m’opérer le plus vite possible. C’est cette lettre qui va me donner l’autorisation de quitter l’Iran parce qu’à ce moment-là, le pays était fermé et la sortie du territoire était devenue interdite aux personnes qui n’avaient pas de raisons très spécifiques.
Cette lettre avec le fait que je m’étais inscrit à la fac lors de mon passage en France dans l’éventualité de reprendre des cours d’urbanisme, m’a permis de dépasser l’interdiction de sortie du territoire. Par chance, j’avais sur moi la feuille d’inscription avec le tampon de la fac française. Pour justifier ma sortie et ma blessure à la main, j’ai raconté que je faisais des études en France et lorsque j’ai appris que la guerre s’était déclarée dans mon pays, j’avais décidé de revenir le soutenir, porté par un acte patriotique. Et maintenant que j’étais blessé, je devais retourner en France me faire soigner et finir mes études. Le type en face de moi qui menait l’interrogatoire parlait un français impeccable, il connaissait Paris parfaitement. J’ai passé trois jours difficiles d’interrogatoire avec lui mais la chose la plus incroyable, c’est que derrière son bureau, il avait un poster d’une photo de moi et que je ne pouvais pas lui dire que c’était moi qui l’avais faite. Chaque jour, je rentrais dans son bureau et je voyais ma photo. C’est seulement le 25 mars 1981, à 7h30 du matin que j’ai quitté mon pays pour ne plus jamais le revoir.
CDM. En vous écoutant, je me demandais si vous avez souvent raconté cette histoire parce que vous avez une mémoire si précise de tous ces événements?
RD. Cela m’est évidement arrivé mais ce n’est pas un exercice que je fais souvent, il y a même des parties de mon histoire que j’essaie d’oublier même si chaque évènement est encore très présent en moi. Il faut dire que chaque moment de vie est déterminant dans ma construction.
CDM. Ce sont des moments qui font véritablement « événement », des moments biographiques.
RD. Quand je sais qu’il y a un évènement à photographier, je contrains mon corps pour aller au cœur de l’évènement et je fais confiance à mon instinct et à ma chance. C’est même arrivé que des rédactions disent à certains journalistes qui allaient sur le front de venir me voir et de me suivre pour éviter le danger.
VB. Il y a aussi quelque chose dans ce que vous racontez où vous cherchez toujours à être au cœur du danger. N’y-a-t-il pas de toute façon dans la photographie toujours ce rapport à la mort?
RD. Il y a un journaliste américain du National Geographic qui m’a suivi en Afghanistan pour un documentaire et à un moment, on voit dans le film des tirs qui viennent de partout et même le journaliste de guerre qui est un des plus courageux est allongé par terre en me criant de me baisser mais pour moi cet environnement est naturel. Je suis conscient aussi que la mort arrivera un jour, je me suis toujours dit : « vis pleinement le moment présent et ne te gâche pas la vie avec ce qui pourrait arriver ».
CDM. Ce qui m’a saisie aussi dans votre narration extrêmement construite, c’est votre émotion, je l’ai ressentie à certains comme étant toujours là. J’ai l’impression que très tôt un germe s’est grainé en vous, sans doute généré par votre indignation devant cet enfant qu’on empêchait d’entrer dans une école et ce germe va croitre. Votre posture de photographe dans des situations extrêmes de guerre, de conflits, de manifestations n’est-elle pas en lien avec ce petit enfant de neuf ans qui voudrait apprendre et qu’on empêche ? Ce qui me touche énormément, c’est qu’il y a chez vous une sorte d’innocence qui vous fait traverser le feu et qui vous protège.
RD. C’est absolument exact parce que finalement tout ce qui reste de ma photographie après cinquante ans de photojournalisme, continue de porter la beauté et l’injustice sociale, ce sont les deux choses qui étaient là dès le départ.
VB. Pour ma part, ce qui m’a marqué dans votre histoire, c’est le rapport au père qui vous valide dans vos choix artistiques et surtout politiques quand il vous dit « ce que tu fais c’est bien mais fait attention » comme s’il vous mettait le cadre et la protection. Et justement je me demandais ce qu’il est advenu de vos parents quand vous avez quitté définitivement l’Iran? Ont-ils été inquiétés après votre départ?
RD. Vingt jours après mon départ, les gardiens de la Révolution qui me cherchaient, arrivent chez mes parents, quand ils apprennent que je suis parti me faire soigner en France, ils commencent à mettre la pression sur ma famille. Mes parents s’inquiètent surtout pour mon neveu qui est orphelin car ma sœur et son mari sont décédés et ils tentent d’organiser son départ vers la France mais il se fait arrêter et emprisonner. À l’époque il y avait 10% de chance de sortir vivant de prison et mon père fait une crise cardiaque à l’annonce de son arrestation.
VB. Et ce neveu était le fils de votre beau-frère qui vous avez offert un de vos premiers appareils photo? Toute votre histoire tourne toujours autour de la photographie?
RD. Oui absolument.
VB. Et ce neveu est sorti de prison?
RD. Oui il est sorti après un an ou deux assez terribles. Il a refait deux fois de la prison et finalement il a réussi à venir s’installer en France. Il travaille aujourd’hui comme ingénieur informatique.
LA RÉVOLUTION
![@Reza]() Contestations secrètes
Contestations secrètes
Lorsque la nuit envahit les ruelles des villes, des ombres furtives et silencieuses se pressent vers les mosquées. Théâtres d’une ferveur nouvelle, celle de la révolte contre les fastes et la répression du pouvoir en place, les mosquées sont les seuls lieux de rassemblement autorisés, comme cette nuit de 1979 à Téhéran, devant Masjed Shah.
La révolution s’est aussi préparée dans le temple d’Allah.
![@Reza]() Une infinie nuance de noirs
Une infinie nuance de noirs
Aux lendemains d’une Révolution iranienne qui s’étira dans le temps, faisant régresser une société toute entière, j’ai vu, pendant des mois, le noir des tchadors envahir les villes et les campagnes. Formes noires d’une époque, il semble que les femmes aient perdu toute individualité. Pourtant, l’Iran est diversité de peuples, d’ethnies, de peaux, multiplicité de couleurs et de paysages. Je revois les femmes et leur jupon coloré qui contrastent avec les maisons en terre, dans les campagnes. Je revois les tapis aux teintes vives, les tissus brodés qui éclairent chaque maison. Je revois les citadines portant des robes seyantes. Je me revois fréquentant des étudiantes qui affichent leurs jambes sous des mini-jupes, ou les soulignent par des pantalons moulants aux pattes d’éléphant.
Lorsque je suis entré dans la boutique de ce marchand du bazar de Téhéran en 1979, où le seul choix possible réside dans la trame du tissu, je me suis senti oppressé. Le modèle est le tchador, et la couleur le noir. J’ai souvent eu l’impression qu’inconsciemment, le peuple d’Iran a consenti à porter le deuil.
LA MANIFESTATION COUVERTE PAR REZA À LA DEMANDE DE GOKSIN. Téhéran, 1979.
![@Reza]() La place des femmes
La place des femmes
Quelques années auparavant, les femmes d’Occident ont brandi leurs dessous au nom de ce qu’elles pensaient être leur libération. En Iran, l’avènement de la République islamique a recouvert les Iraniennes d’un voile et d’un long manteau. Leur corps caché, leur individualité et leur droit à la différence perdus sous l’uniforme au nom d’une idéologie, elles ont gagné le titre « prestigieux » de « sœur ». On leur a fait croire qu’elles seraient considérées à l’égal de l’homme, et on leur a mis un fusil dans la main. Des femmes, appelées « les sœurs de Zahra », sont chargées de traquer avec cruauté dans les rues le manteau trop court, le vernis sur les ongles, les mèches échappées du voile, les rencontres furtives de mains d’amoureux. Sans pitié, elles ont fait chèrement payer celles et ceux qui osaient transgresser l’ordre nouveau, celui de la République islamique.
TÉHÉRAN, 1980.
![@Reza]() « Rien »
« Rien »
La porte s’ouvre sur mon ultime demande de le photographier dans l’intimité. C’est ainsi ma dernière chance pour tenter de comprendre l’ayatollah Khomeyni. Il est assis sur un lit, dans une chambre vide, sans passé ni futur, sans histoire ni mémoire. Elle est nue. La scène est insolite. J’ai le temps de prendre trois photos. Puis il me congédie d’un brutal : « Je suis fatigué. » Tout au long de cette prise de vue, j’ai cherché en vain son regard afin de faire taire un doute qui est en moi depuis le jour de son retour en Iran, un an auparavant. Quand son avion d’Air France est entré dans l’espace aérien iranien, un journaliste lui a posé cette question : « Vous rentrez de quinze ans d’exil. Que ressentez-vous ? » Il avait alors répondu : « Rien. » Pourtant, en ces temps-là, Khomeyni était le symbole de l’espoir de tout un peuple en marche vers une révolution sans nom.
Alors, au cours de notre bref face-à-face, le doute en moi laisse place à la certitude qu’une chape de plomb va s’abattre sur les rêves de justice et de liberté d’un peuple et sur mon pays.
PRISE D’OTAGE DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE
![@Reza]() Les marionnettes de l’Histoire
Les marionnettes de l’Histoire
Des étudiantes du groupe des preneurs d’otages, vêtues de tchadors noir - le nouvel « uniforme » après l’avènement de Khomeyni - manifestent à l’intérieur de l’ambassade américaine occupée où cinquante-trois diplomates américains sont détenus. Une installation artistique dénonce le rôle de marionnettiste d’une Amérique qui « joue » avec le monde, comme avec des poupées. L’Occident est représenté par les doigts, l’Amérique est diabolisée. Et pourtant, en cet instant, celles qui sont clairement utilisées par le régime islamique sont ces jeunes femmes revendicatrices, au visage cerné de noir. Entre les doigts difformes des mains menaçantes, ces étudiantes, exhibées sur le devant de la scène, ne sont-elles pas de simples marionnettes d’une Histoire qu’ont décidé d’écrire les mollahs depuis la Révolution ? Nombre de leurs collègues masculins ont par la suite, et pour certains quarante ans après, occupé des postes importants au gouvernement.
![@Reza]() The show must go on
The show must go on
Depuis l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis par les étudiants islamistes et la détention des cinquante-trois diplomates américains, l’Iran a gagné l’attention des médias internationaux, qu’ils tiennent en haleine. L’entrée principale de l’ambassade était flanquée de deux piliers, dont l’un jouxtait la guérite qui abritait en temps normal le gardien et les agents de sécurité. Mais après que les droits du sol de l’ambassade ont été bafoués, la toiture de la guérite est devenue une tribune, pour les étudiants mais aussi pour toutes les personnalités du pays. Ils haranguent une foule venue en pèlerinage des régions les plus reculées, et prennent à témoin les journalistes des quatre coins du monde, massés devant les grilles fermées. Tout n’est que spectacle. Brûler le drapeau américain sous l’œil des caméras et des appareils photo, c’est assurer une couverture médiatique imparable du sentiment anti-américain et plus globalement anti-occidental, fomenté et entretenu par le jeune et redoutable gouvernement des mollahs.
![@Reza]()
Téhéran ambassade américaine, 1980
L’illusion de présence
Dans les premières années de la révolution iranienne, un événement tient en haleine le monde entier pendant 444 jours : la prise en otage par des étudiants islamistes de cinquante-trois diplomates dans l’enceinte de l’ambassade américaine. Celle-ci devient une tribune accordée par les mollahs à certains « opprimés ». Ce jour-là, un étudiant irakien opposant à Saddam Hussein, le dirigeant de l’Irak également ennemi du jeune régime islamique iranien, tient un discours, le visage dissimulé, lors d’une conférence de presse. Ce sont ces provocations constantes devant les médias de ses opposants réfugiés en Iran avec le soutien du gouvernement iranien, qui ont suscité l’ire du dirigeant irakien et ont constitué un élément déclencheur du conflit entre les deux pays. Plus tard, Khomeyni a reconnu sa part de responsabilité dans le déclenchement de ce conflit. La mobilisation du peuple pour se défendre a permis au jeune régime de se maintenir.
Sur cette photo, au premier regard, Khomeyni semble présent. En réalité, c’est une photographie, à taille réelle ; les lignes du micro orange créent une perspective hors champ et l’illusion de sa présence en personne. Cette illusion fait écho à l’omniprésence visuelle de Khomeyni dans l’ensemble du pays, à travers des représentations sous forme de photographie ou de peinture.
GUERRE IRAN IRAQ
![@Reza]() Province du Khuzestan, près de la ville de Susangerd, 1981.
Province du Khuzestan, près de la ville de Susangerd, 1981.
![@Reza]() Ahwaz, septembre 1980.
Ahwaz, septembre 1980.
L’envers du décor
Avant la guerre, sur les murs des villes, les photographes dressaient des décors de montagnes, de paysages, de monuments historiques ou religieux, devant lesquels les gens venaient se faire photographier.
La guerre a changé le décor dans la ville d’Ahwaz, sur la route du front d’une guerre avec l’Irak qui dura huit longues années. Les passants sont invités à prendre position derrière un char, près d’un hélicoptère peint.
Mais derrière cette toile peinte, la vision ne présage-t-elle pas du champ de ruines que deviendrait le pays ?
![@Reza]() Téhéran, 1980.
Téhéran, 1980.
Vol d’enfances
Comment raconter les enfants dans la guerre ? Comment dire cette machine qui broie l’insouciance ? Nombreuses sont les photographies, dans nos archives, d’innocents otages d’un monde d’adultes en folie. A Téhéran, la foule en liesse fête un anniversaire de la Révolution. Un gigantesque défilé se prépare, qui doit témoigner visuellement de la ferveur d’un peuple pour son guide spirituel, l’imam Khomeyni et pour son projet d’une société embrigadée religieusement. La ferveur ? Oui. Il est même question de celle, contrainte, des enfants. Dans leur tenue militaire, ils sont entraînés à marcher comme des soldats enrôlés et à crier des slogans en rythme, encouragés par leur instructeur sans pitié. Et ce jeune enfant soldat, près du front de guerre avec l’Irak, prêt à mourir pour un morceau de paradis promis, portant, inconscient et joyeux, des mines anti-personnel.
Où sont les comptines et les jeux ? Où sont les visages rieurs et enfantins ? La monstruosité de l’embrigadement, cette menace qui a rongé la jeune génération iranienne d’alors est partout dans nos archives. Quarante ans plus tard, la menace est une triste réalité. Les enfants ont grandi. Ceux qui sont encore en vie, quels adultes sont-ils devenus ? Quel rêve ont-ils pu poursuivre ?
KURDISTAN
![@Reza]() « Filles et fils de Satan »
« Filles et fils de Satan »
Tels sont les mots terribles utilisés par les mollahs tout juste arrivés au pouvoir pour désigner les Kurdes, justifiant toute action sanglante de répression à leur encontre.
Dans la ville kurde de Baneh, plusieurs fois assiégée entre 1979 et 1980, une bombe a touché mortellement Peyman et sa sœur Leila.
![@Reza]() Exécution.
Exécution.
En réponse au bombardement sans relâche du Kurdistan par le gouvernement des mollahs, des femmes, des paysans, des intellectuels ont pris les armes et le maquis. D’autres, les civils, s’organisent en une résistance passive et constante. Les prisons étant surpeuplées d’innocents en quête de liberté, les mosquées sont transformées en geôles. Arrêté en plein reportage dans la ville de Sanandadj, en cette année 1980, j’ai pu cacher les quelques rouleaux de films pris, avant d’être conduit à l’interrogatoire. A l’entrée de la mosquée, j’ai eu le temps de saisir en cachette cet homme aux yeux bandés attendant sa possible exécution, comme des dizaines d’autres.
![@Reza]() Hanté par les chagrins de la violence.
Hanté par les chagrins de la violence.
Quarante ans après, je me souviens encore de chaque instant. Je me suis laissé enfermer dans la région du Kurdistan. Les Gardiens de la révolution l’ont bouclée pour mieux bombarder ses habitants dans le silence de l’indifférence. Je veux témoigner ; ma seule arme est mon appareil photo. Depuis des jours, je vais de hameau en village, d’instant quotidien en chagrin, de résignation en détermination. Dans la cour d’une maison de la ville assiégée de Baneh, ce jour de 1980, j’ai pris un thé avec un vieil homme et ses petits-enfants, Peyman et sa sœur Leila. Des moments de grâce volés à la violence. Le thé offert était chaud dans la froideur de mon errance visuelle de photographe solitaire ; les rires tendres des enfants tranchaient avec la brutalité des sifflements des balles et des impacts de bombes lâchées sur le sol.
Je les ai laissés à leur humanité.
Quelques brefs instant plus tard, je me souviens du chaos, du feu, des cris, du sang.
Suite au bombardement de l’artillerie lourde de la République islamique d’Iran, la mère de Payman et de Leila hurle la mort de ses enfants.
L’EXIL
![@Reza]() Iran, 1981.
Iran, 1981.
La complainte de la séparation
Quand j’ai commencé mon voyage hors de mon pays, lorsque les événements m’ont contraint à l’exil, l’Iran était devenu un grand cimetière au milieu de la Terre, où des formes noires erraient parmi les tombes.
![]() France, Paris.
France, Paris.
L’exil
Le 25 mars 1981, à 7h35 du matin, j’ai quitté mon pays avec mon sac d’appareils, puisque c’était au nom de mes témoignages que j’étais condamné. J’ai commencé ma longue route de l’exil.
Mon voyage intérieur est l’errance d’un nomade autour de la terre interdite. Mes premières années d’exil furent sans aucun doute marquées par ce choc entre l’image rêvée d’un Occident libre et la réalité de ses démocraties. Ma liberté avait le visage vide et mon exil était doute et tristesse. Au cimetière du Père-Lachaise à Paris, un jour pluvieux et sombre de novembre, un long cortège d’exilés iraniens se rassemble pour une première expérience : l’abysse d’un ami mort dans cet ailleurs. Ce jour-là, nous sommes tous venus accompagner Sa’edi, ce penseur et écrivain iranien contraint lui aussi à l’ailleurs, dans sa dernière demeure. Nous avons alors goûté l’amertume de la mort dans cet exil, et imaginé la chair mêlée à la terre qui n’est pas sienne. Quelque temps après, le poète Shamlou, regardant cette image, dit ce poème : « Même la pierre pleure et gémit, le jour de la séparation du bien-aimé. »
 Contestations secrètes
Contestations secrètesLorsque la nuit envahit les ruelles des villes, des ombres furtives et silencieuses se pressent vers les mosquées. Théâtres d’une ferveur nouvelle, celle de la révolte contre les fastes et la répression du pouvoir en place, les mosquées sont les seuls lieux de rassemblement autorisés, comme cette nuit de 1979 à Téhéran, devant Masjed Shah.
La révolution s’est aussi préparée dans le temple d’Allah.
 Une infinie nuance de noirs
Une infinie nuance de noirsAux lendemains d’une Révolution iranienne qui s’étira dans le temps, faisant régresser une société toute entière, j’ai vu, pendant des mois, le noir des tchadors envahir les villes et les campagnes. Formes noires d’une époque, il semble que les femmes aient perdu toute individualité. Pourtant, l’Iran est diversité de peuples, d’ethnies, de peaux, multiplicité de couleurs et de paysages. Je revois les femmes et leur jupon coloré qui contrastent avec les maisons en terre, dans les campagnes. Je revois les tapis aux teintes vives, les tissus brodés qui éclairent chaque maison. Je revois les citadines portant des robes seyantes. Je me revois fréquentant des étudiantes qui affichent leurs jambes sous des mini-jupes, ou les soulignent par des pantalons moulants aux pattes d’éléphant.
Lorsque je suis entré dans la boutique de ce marchand du bazar de Téhéran en 1979, où le seul choix possible réside dans la trame du tissu, je me suis senti oppressé. Le modèle est le tchador, et la couleur le noir. J’ai souvent eu l’impression qu’inconsciemment, le peuple d’Iran a consenti à porter le deuil.
LA MANIFESTATION COUVERTE PAR REZA À LA DEMANDE DE GOKSIN. Téhéran, 1979.
 La place des femmes
La place des femmesQuelques années auparavant, les femmes d’Occident ont brandi leurs dessous au nom de ce qu’elles pensaient être leur libération. En Iran, l’avènement de la République islamique a recouvert les Iraniennes d’un voile et d’un long manteau. Leur corps caché, leur individualité et leur droit à la différence perdus sous l’uniforme au nom d’une idéologie, elles ont gagné le titre « prestigieux » de « sœur ». On leur a fait croire qu’elles seraient considérées à l’égal de l’homme, et on leur a mis un fusil dans la main. Des femmes, appelées « les sœurs de Zahra », sont chargées de traquer avec cruauté dans les rues le manteau trop court, le vernis sur les ongles, les mèches échappées du voile, les rencontres furtives de mains d’amoureux. Sans pitié, elles ont fait chèrement payer celles et ceux qui osaient transgresser l’ordre nouveau, celui de la République islamique.
TÉHÉRAN, 1980.
 « Rien »
« Rien »La porte s’ouvre sur mon ultime demande de le photographier dans l’intimité. C’est ainsi ma dernière chance pour tenter de comprendre l’ayatollah Khomeyni. Il est assis sur un lit, dans une chambre vide, sans passé ni futur, sans histoire ni mémoire. Elle est nue. La scène est insolite. J’ai le temps de prendre trois photos. Puis il me congédie d’un brutal : « Je suis fatigué. » Tout au long de cette prise de vue, j’ai cherché en vain son regard afin de faire taire un doute qui est en moi depuis le jour de son retour en Iran, un an auparavant. Quand son avion d’Air France est entré dans l’espace aérien iranien, un journaliste lui a posé cette question : « Vous rentrez de quinze ans d’exil. Que ressentez-vous ? » Il avait alors répondu : « Rien. » Pourtant, en ces temps-là, Khomeyni était le symbole de l’espoir de tout un peuple en marche vers une révolution sans nom.
Alors, au cours de notre bref face-à-face, le doute en moi laisse place à la certitude qu’une chape de plomb va s’abattre sur les rêves de justice et de liberté d’un peuple et sur mon pays.
PRISE D’OTAGE DE L’AMBASSADE AMÉRICAINE
 Les marionnettes de l’Histoire
Les marionnettes de l’Histoire Des étudiantes du groupe des preneurs d’otages, vêtues de tchadors noir - le nouvel « uniforme » après l’avènement de Khomeyni - manifestent à l’intérieur de l’ambassade américaine occupée où cinquante-trois diplomates américains sont détenus. Une installation artistique dénonce le rôle de marionnettiste d’une Amérique qui « joue » avec le monde, comme avec des poupées. L’Occident est représenté par les doigts, l’Amérique est diabolisée. Et pourtant, en cet instant, celles qui sont clairement utilisées par le régime islamique sont ces jeunes femmes revendicatrices, au visage cerné de noir. Entre les doigts difformes des mains menaçantes, ces étudiantes, exhibées sur le devant de la scène, ne sont-elles pas de simples marionnettes d’une Histoire qu’ont décidé d’écrire les mollahs depuis la Révolution ? Nombre de leurs collègues masculins ont par la suite, et pour certains quarante ans après, occupé des postes importants au gouvernement.
 The show must go on
The show must go onDepuis l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis par les étudiants islamistes et la détention des cinquante-trois diplomates américains, l’Iran a gagné l’attention des médias internationaux, qu’ils tiennent en haleine. L’entrée principale de l’ambassade était flanquée de deux piliers, dont l’un jouxtait la guérite qui abritait en temps normal le gardien et les agents de sécurité. Mais après que les droits du sol de l’ambassade ont été bafoués, la toiture de la guérite est devenue une tribune, pour les étudiants mais aussi pour toutes les personnalités du pays. Ils haranguent une foule venue en pèlerinage des régions les plus reculées, et prennent à témoin les journalistes des quatre coins du monde, massés devant les grilles fermées. Tout n’est que spectacle. Brûler le drapeau américain sous l’œil des caméras et des appareils photo, c’est assurer une couverture médiatique imparable du sentiment anti-américain et plus globalement anti-occidental, fomenté et entretenu par le jeune et redoutable gouvernement des mollahs.

Téhéran ambassade américaine, 1980
L’illusion de présence
Dans les premières années de la révolution iranienne, un événement tient en haleine le monde entier pendant 444 jours : la prise en otage par des étudiants islamistes de cinquante-trois diplomates dans l’enceinte de l’ambassade américaine. Celle-ci devient une tribune accordée par les mollahs à certains « opprimés ». Ce jour-là, un étudiant irakien opposant à Saddam Hussein, le dirigeant de l’Irak également ennemi du jeune régime islamique iranien, tient un discours, le visage dissimulé, lors d’une conférence de presse. Ce sont ces provocations constantes devant les médias de ses opposants réfugiés en Iran avec le soutien du gouvernement iranien, qui ont suscité l’ire du dirigeant irakien et ont constitué un élément déclencheur du conflit entre les deux pays. Plus tard, Khomeyni a reconnu sa part de responsabilité dans le déclenchement de ce conflit. La mobilisation du peuple pour se défendre a permis au jeune régime de se maintenir.
Sur cette photo, au premier regard, Khomeyni semble présent. En réalité, c’est une photographie, à taille réelle ; les lignes du micro orange créent une perspective hors champ et l’illusion de sa présence en personne. Cette illusion fait écho à l’omniprésence visuelle de Khomeyni dans l’ensemble du pays, à travers des représentations sous forme de photographie ou de peinture.
GUERRE IRAN IRAQ
 Province du Khuzestan, près de la ville de Susangerd, 1981.
Province du Khuzestan, près de la ville de Susangerd, 1981.  Ahwaz, septembre 1980.
Ahwaz, septembre 1980.
L’envers du décor
Avant la guerre, sur les murs des villes, les photographes dressaient des décors de montagnes, de paysages, de monuments historiques ou religieux, devant lesquels les gens venaient se faire photographier.
La guerre a changé le décor dans la ville d’Ahwaz, sur la route du front d’une guerre avec l’Irak qui dura huit longues années. Les passants sont invités à prendre position derrière un char, près d’un hélicoptère peint.
Mais derrière cette toile peinte, la vision ne présage-t-elle pas du champ de ruines que deviendrait le pays ?
 Téhéran, 1980.
Téhéran, 1980. Vol d’enfances
Comment raconter les enfants dans la guerre ? Comment dire cette machine qui broie l’insouciance ? Nombreuses sont les photographies, dans nos archives, d’innocents otages d’un monde d’adultes en folie. A Téhéran, la foule en liesse fête un anniversaire de la Révolution. Un gigantesque défilé se prépare, qui doit témoigner visuellement de la ferveur d’un peuple pour son guide spirituel, l’imam Khomeyni et pour son projet d’une société embrigadée religieusement. La ferveur ? Oui. Il est même question de celle, contrainte, des enfants. Dans leur tenue militaire, ils sont entraînés à marcher comme des soldats enrôlés et à crier des slogans en rythme, encouragés par leur instructeur sans pitié. Et ce jeune enfant soldat, près du front de guerre avec l’Irak, prêt à mourir pour un morceau de paradis promis, portant, inconscient et joyeux, des mines anti-personnel.
Où sont les comptines et les jeux ? Où sont les visages rieurs et enfantins ? La monstruosité de l’embrigadement, cette menace qui a rongé la jeune génération iranienne d’alors est partout dans nos archives. Quarante ans plus tard, la menace est une triste réalité. Les enfants ont grandi. Ceux qui sont encore en vie, quels adultes sont-ils devenus ? Quel rêve ont-ils pu poursuivre ?
KURDISTAN
 « Filles et fils de Satan »
« Filles et fils de Satan »Tels sont les mots terribles utilisés par les mollahs tout juste arrivés au pouvoir pour désigner les Kurdes, justifiant toute action sanglante de répression à leur encontre.
Dans la ville kurde de Baneh, plusieurs fois assiégée entre 1979 et 1980, une bombe a touché mortellement Peyman et sa sœur Leila.
 Exécution.
Exécution. En réponse au bombardement sans relâche du Kurdistan par le gouvernement des mollahs, des femmes, des paysans, des intellectuels ont pris les armes et le maquis. D’autres, les civils, s’organisent en une résistance passive et constante. Les prisons étant surpeuplées d’innocents en quête de liberté, les mosquées sont transformées en geôles. Arrêté en plein reportage dans la ville de Sanandadj, en cette année 1980, j’ai pu cacher les quelques rouleaux de films pris, avant d’être conduit à l’interrogatoire. A l’entrée de la mosquée, j’ai eu le temps de saisir en cachette cet homme aux yeux bandés attendant sa possible exécution, comme des dizaines d’autres.
 Hanté par les chagrins de la violence.
Hanté par les chagrins de la violence. Quarante ans après, je me souviens encore de chaque instant. Je me suis laissé enfermer dans la région du Kurdistan. Les Gardiens de la révolution l’ont bouclée pour mieux bombarder ses habitants dans le silence de l’indifférence. Je veux témoigner ; ma seule arme est mon appareil photo. Depuis des jours, je vais de hameau en village, d’instant quotidien en chagrin, de résignation en détermination. Dans la cour d’une maison de la ville assiégée de Baneh, ce jour de 1980, j’ai pris un thé avec un vieil homme et ses petits-enfants, Peyman et sa sœur Leila. Des moments de grâce volés à la violence. Le thé offert était chaud dans la froideur de mon errance visuelle de photographe solitaire ; les rires tendres des enfants tranchaient avec la brutalité des sifflements des balles et des impacts de bombes lâchées sur le sol.
Je les ai laissés à leur humanité.
Quelques brefs instant plus tard, je me souviens du chaos, du feu, des cris, du sang.
Suite au bombardement de l’artillerie lourde de la République islamique d’Iran, la mère de Payman et de Leila hurle la mort de ses enfants.
L’EXIL
 Iran, 1981.
Iran, 1981.La complainte de la séparation
Quand j’ai commencé mon voyage hors de mon pays, lorsque les événements m’ont contraint à l’exil, l’Iran était devenu un grand cimetière au milieu de la Terre, où des formes noires erraient parmi les tombes.
 France, Paris.
France, Paris. L’exil
Le 25 mars 1981, à 7h35 du matin, j’ai quitté mon pays avec mon sac d’appareils, puisque c’était au nom de mes témoignages que j’étais condamné. J’ai commencé ma longue route de l’exil.
Mon voyage intérieur est l’errance d’un nomade autour de la terre interdite. Mes premières années d’exil furent sans aucun doute marquées par ce choc entre l’image rêvée d’un Occident libre et la réalité de ses démocraties. Ma liberté avait le visage vide et mon exil était doute et tristesse. Au cimetière du Père-Lachaise à Paris, un jour pluvieux et sombre de novembre, un long cortège d’exilés iraniens se rassemble pour une première expérience : l’abysse d’un ami mort dans cet ailleurs. Ce jour-là, nous sommes tous venus accompagner Sa’edi, ce penseur et écrivain iranien contraint lui aussi à l’ailleurs, dans sa dernière demeure. Nous avons alors goûté l’amertume de la mort dans cet exil, et imaginé la chair mêlée à la terre qui n’est pas sienne. Quelque temps après, le poète Shamlou, regardant cette image, dit ce poème : « Même la pierre pleure et gémit, le jour de la séparation du bien-aimé. »
