
Comment je ne suis pas devenu photographe.
Par Geoges Bardawil, 2014Après tous ces souvenirs livrés à la diable, peut-être avez-vous envie d’en savoir un peu plus sur l’auteur de ce blog, et que je vous raconte comment, à défaut de devenir photographe, mes yeux se sont ouverts à la Photographie?
Au cours des nombreuses années passées à côtoyer des photographes sans nombre, à m’occuper de trois magazines, à créer une galerie, je me suis plus d’une fois entendu demander, si l’envie de devenir moi-même photographe, ne m’avait jamais effleuré.
Je m’en tirais, la plupart du temps par une de mes habituelles pirouettes, une boutade du genre : « Si, bien sûr, mais... j’ai préféré apprendre à lire et à écrire... » J’aurais pu tout aussi bien répondre, ce qui était plus proche de la vérité : « Je n’aurais pas demandé mieux, mais chaque fois que j’avais un appareil de photo, un sort malicieux voulait que je le casse, qu’il se perde ou qu’on me le dérobe...» Et il en fut ainsi, jusqu’à cet Exakta Réflex «avec visée à travers l’objectif» que dans un temps de vaches maigres, il me fallut vendre au père d’un de mes proches amis.
Il y eût aussi, maintenant que j’y pense, la superbe chambre 18x24 en bois blond, qu’avant son départ à la retraite le dernier ébéniste de Gilles Faller devait bichonner tout exprès pour le dernier Pdg de la société que j’étais. Un vrai bijou. Une relique. Elle pouvait être équipée d’un dos polaroïd. Avant même que je fasse la moindre photo avec, Walter Carone, qui avait la passion des appareils, tint absolument à – disons -, la dépuceler. Dans les jours qui suivirent, avant même qu’il ait eu le temps de faire le moindre essai, il fut victime d’un cambriolage. Et ma petite merveille disparut... Le dos polaroïd avec...
Une vie nomade, quelques dix-sept déménagements, un incendie, et pas mal de négligences, ayant eu raison de la quasi-totalité des tirages et des négatifs que j’aurais pu, que j’aurais du conserver, il ne me reste que fort peu de traces de ces années où je faillis me prendre pour un « photographe ». Entre autre, deux photos.


La première, prise à Marseille dans une ruelle de ce quartier malfamé du « Panier » où j’avais passé ma prime jeunesse, eût l’honneur d’être retenue et publiée dans le cadre d’un concours organisé par un magazine (Point de vue-Image du monde, je pense) auquel je l’avais adressée. C’est lors de mon premier voyage à Paris que je devais prendre la deuxième, celle de cette prostituée faisant le trottoir devant toute une série d’affiches qui, à les regarder de près, semblait les légendes de son vieux métier.
Je m’étais laissé dire, un jour, (je ne sais plus par qui ni en quelle occasion), que Robert Doisneau, qui l’avait vue, s’en était amusé et avait dit qu’ll aurait bien aimé l’avoir faite. Je l’avais prise rue Saint-Denis, non loin du magasin d’un jeune marchand (entre autres) de chaussures, qui s’était pris d’amitié pour le jeune homme que j’étais. Un des nombreux allers-retours entre Paris et Marseille qu’il effectuait, devait bientôt mettre un terme à notre amitié et à sa vie. Elle se termina sur un platane de la N 7 tandis que je photographiais la Kabylie avec le premier Leica qu’un autre ami, dentiste, m’avait prêté. Je préférais ce bon vieil appareil au pistolet-mitrailleur dont j’étais supposé me servir pour défendre le colonel que j’accompagnais en tant que secrétaire. J’avais tout juste vingt ans, en Kabylie.
Ces deux photos, - je peux maintenant le dire - je les avais tirées moi-même. J’ignore ce qui m’avait empêché d’en faire état jusqu’ici... Ni pourquoi, je n’ai jamais non plus signalé que je n’ignorais rien de ce qui s’opère dans la pénombre rougeâtre d’un laboratoire. Il se trouve que j’ai commencé par le taire, jusqu’à n’y plus penser.
Celui qui devait m’enseigner les rudiments du développement et du tirage, était une (déjà) vieille connaissance, recroisée par le plus grand hasard, le jour même où je m’étais mis en tête de trouver quelqu’un susceptible de m’en apprendre l’abc. Et j’étais justement en train de penser à lui, que je n’avais pas vu depuis longtemps, et qui se trouvait être une des très rares pour ne pas dire la seule personne de ma connaissance dont la photo était le métier. Je l’avais connu lorsqu’il avait fait la prise de vue de cette photographie que je ne résiste pas à l’envie de vous montrer.

Je sais, pour en avoir fait maintes fois l’expérience, que certaines photographies ont, plus que d’autres, le pouvoir de nous parler de la manière dont nos vies se tricotent ou pour mieux dire, se trament. Parfois, pour peu qu’on sache les questionner, non contentes d’évoquer comme il se doit le passé, elles nous parlent des choses à venir. A la manière des rêves prémonitoires. Un peu comme dans ce miroir où Montaigne nous conseillait de « nous regarder pour nous connaître de bon biais ». En prenant, toute fois, bien garde d’oublier ce que Lewis Caroll - en bon vieux photographe du temps d’avant le Leica et le numérique - disait à Alice en l’invitant à le traverser : « Tout y est juste comme chez nous, mais toujours à l’envers. »
Cette photo-là, prise en 1947, semble ne représenter qu’un groupe de jeunes acteurs. Ce sont ceux de la troupe du Galion d’Or jouant l’Antigone d’Anouilh, à Marseille.
Autant vous dire tout de suite que le garçonnet sage en chemise blanche et costume sombre, c’est moi. On m’a choisi pour jouer le page. Je dois avoir tout au plus douze ans, et ne pense qu’au théâtre et à la poésie. Mais aussi, à l’archéologie. C’est un archélogue libanais du nom de Boustani ami de mon père, qui m’en a un jour donné le goût au point de me faire opter pour le latin puis le grec. Seul à l’avoir choisi en quatrième, je l’apprendrai en tête à tête avec un professeur qui, entre deux traductions de Grégoire de Nazians ou Saint Jean Chrysostome, me fera lire Teilhard de Chardin en ronéotypé, faute d’avoir l’imprimatur. Nous voilà loin encore, de la photographie et du cinéma.
Le monsieur à mes côtés, c’est André Rosch, le directeur de la troupe qui tient le rôle de Créon. Il me racontera qu’il a un fils d’à peu près mon âge qu’il a eu quand il avait lui-même treize ans. Ce sont des choses qui marquent un enfant. Assis devant moi, le frère du photographe. C’est un ami de mon professeur d’anglais à qui je dois ce rôle, et d’être, cela va de soi, le chouchou de la troupe.
Assise à l’extrême droite, c’est Marie-Ange Dutheil qui a dû abandonner le Conservatoire pour incarner cette Antigone. Elle ne pleure pas seulement son frère, et partira bientôt pour Paris où elle poursuivra sa carrière et épousera le poète-libraire Marcel Béalu, l’ami de Max Jacob et des surréalistes.
Quelques six ou sept ans plus tard, fraîchement débarqué dans la capitale, je retrouverai mon Antigone libraire à Paris. Moderne Eurydice, elle tient entre deux rôles pour son poète de mari, la librairie du Pont-traversé, qu’il vient d’ouvrir rue Saint Séverin. C’est là que devenu un client familier j’achèterai entre autres, ma collection des Cahiers de la Pléïade. Mon Antigone disparaitra après avoir joué dans le film d’épouvante tiré de l’Araignée d’eau, une nouvelle de son mari. L’autre comédienne qui joue l’héroïne fatale de ce film, c’est Elizabeth Wiener, la fille de Jean Wiener, le compositeur et pianiste du Bœuf sur le Toit et de la monteuse Suzanne de Troye dont je serai le porte-plume pour sa rubrique régulière sur le montage des films du magazine PHOTO.
Sur cette photographie dont je vous parle, il y a encore deux absents qui valent d’être mentionnés. Il s’agit naturellement du décorateur, et bien sûr du photographe. Le premier, c’est René Allio qui sera bientôt scénographe puis réalisateur. A la sortie de La vieille dame indigne, son premier film qui eût un certain succès, je le retrouverai à une de ces projections privées où j’accompagnais Albert Cervoni, critique de cinéma passé de La Marseillaise à l’Humanité.
Le deuxième absent, qui va compter davantage, s’appelle Claude Lelièvre : c’est l’auteur de la photographie, mais aussi celui auprès duquel j’apprendrai bientôt l’abc du laboratoire... Et diverses autres choses concernant la photographie.
Pendant toutes les années qui suivirent les prises de vues qu’il était venu faire au théâtre, le hasard avait voulu que nous nous croisions à plusieurs reprises. Jamais sans qu’il ne s’arrête pour m’adresser quelques mots gentils. Et puis, comme cela se passe dans la vie, nous étions perdus de vue durant plusieurs années.
Ce jour-là, lorsque nous nous dirigeons l’un vers l’autre dans une petite rue non loin du Vieux-Port, c’est moi qui le reconnais le premier. C’est logique : je suis à l’âge où l’on change et je pensais justement à lui. Remarquant l’appareil pendu à mon cou, il m’interroge sur les photos que je fais ; il m’invite à venir les lui montrer dans le studio tout proche, où il vient de s’établir à son compte. C’est à deux pas des Cahiers du Sud où, à l’époque, je me rends fréquemment.
Lors des mois qui précédèrent mon départ pour la capitale où j’avais rendez-vous, croyais-je, avec le cinéma, je cherchais tout ce qui était de nature à me distraire d’un baccalauréat dans lequel l’impatience de ma jeunesse me poussait à ne voir qu’un passage obligé vers une vie universitaire sans intérêt pour moi et tout juste bonne à retarder mon entrée dans la vie active. Le temps que j’allais passer à apprendre la photographie chez mon ami Claude Lelièvre allait être un de mes passe-temps favoris.
Sans être lui-même un grand photographe, il connaissait son métier, le portrait classique en studio, et bien sûr le laboratoire, développements et tirages que ses clients, encore rares, préféraient sur papier chamois. Ayant tout son temps et un esprit curieux, il m’enseignait volontiers tout ce qu’il savait du tirage des photographies et ne demandait pas mieux que de faire d’après des images que je trouvais dans certaines publications, toutes sortes d’expériences : solarisations à la Man Ray ou « Rayogrammes », que nous composions avec des lunettes, des trousseaux de clés, des feuilles mortes et autres petits objets.
C’est donc avec lui, puis sur ses conseils, que je développais et tirais bientôt moi-même, mes photographies.
Je devrais avoir encore quelque part par là, dans le désordre d’une fin de vie qu’on n’ose plus trop chambouler, une petite coupure de presse du Canard Enchaîné qu’une de mes sœurs aînées conservait telle une relique. Elle datait des tout derniers moments de la guerre d’Indochine en 1954 et représentait la photo que j’avais envoyée à l’hebdo satyrique. C’était au moment de ce qu’on appelait « l’affaire des fuites », un de ces imbroglios politico-politiciens auxquels Mitterrand avait coutume de se trouver mêlé. Un jour que je me baladais dans la campagne aixoise du côté du Tholonet, j’avais trouvé dans une décharge sauvage un vieux bidet cassé où quelqu’un avait cru bon de se débarrasser d’un quotidien froissé dont le titre bien gras sur quatre colonnes, était « L’Affaire des fuites ».
C’est sans doute de là, du Canard Enchaîné, quand j’y repense, que m’étais revenue la remarque de Doisneau à propos de ma photo de la rue Saint-Denis dont je parlais plus haut. Doisneau et le Canard enchaîné devaient d’ailleurs un jour, bien plus tard se retrouver réunis pour moi.
C’était en septembre 1974, quand l’exposition de Doisneau à la Photogalerie eût droit dans le journal satyrique, à un joli poème du Petit Lettré faisant rimer « rue Christine » avec « gélatine ». Ce n’était pas tous les jours que le Canard sortait une de ses plus belles plumes pour une exposition de photographies.
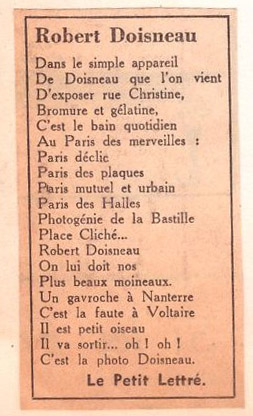
Tout ça pour vous dire que j’avais sans doute bien mieux à faire que de donner au monde un photographe de plus. La photographie et moi, ne pouvions qu’y gagner.
Sans doute avais-je justement pressenti, avant même que la vie ne vienne me donner raison, qu’il me manquerait toujours les deux qualités essentielles qui font le Photographe comme d’ailleurs elles font, au delà de tout talent, le Peintre, le Sculpteur, l’Ecrivain, le Compositeur.
La première est cette partialité, ce dévouement égotiste de celui qui ne peut avoir d’yeux que pour son œuvre. La deuxième est cette obsession absolue de chaque instant qui fait de cette œuvre unique, reconnaissable, à nulle autre pareille, son unique raison d’être. Cela peut même aller de pair, chez certains, avec l’esprit du collectionneur possédé par la manie de l’accumulation. Plus que dans tous les arts, c’est flagrant dans la photographie, où bien des œuvres, sont faites d’un seul sujet : regardez Atget et les innombrables rues de Paris, Curtis et les milliers Indiens, Bellocq et les prostituées de la Nouvelle-Orléans, sans parler de l’éternel jeune Lartigue dont les milliers d’images sur la joie de vivre remplissent les albums de toute une longue vie... Et d’autres encore que j’oublie... En d’autres temps, à l’époque où nos mondes étaient moins grands, plus étanches, Koudelka s’en serait peut-être tenu aux seuls gitans.
Pour qu’une photographie de Bill Brandt, n’ait rien à voir avec celle de Man Ray, de Doisneau, de Paul Strand ou de Cartier-Bresson, il faut bien plus que de l’habilité, du savoir faire ou de ce « fétichisme de la technique » dont parle Henri Cartier-Bresson. Il faut une fidélité absolue (pour ne pas dire aveugle) à la vision qu’un individu a du monde, à l’idée qu’il s’en fait, à ces quelques seules fractions de seconde qu’il choisit d’en retenir.
De nature à être « fidèle plutôt deux fois qu’une », touché par tout, bien plus encore que touche à tout, peu enclin à posséder ce qui m’empêcherait de rêver de ce que je ne possédais pas, plutôt que de me contenter de prendre les quelques centaines de photographies qui auraient pu faire «mes trois secondes d’éternité» dont parle Robert Doisneau, je préférais rester libre de prendre tous les instants décisifs des autres.
C’est sans doute pour cela que je prenais depuis longtemps déjà, tant de plaisir à me promener, à me plonger dans les photos des autres.
Cela faisait déjà longtemps et datait, d’autant que je me souvienne de la fin des années quarante, quand, avec les appétits insatiables de mes quatorze quinze ans, - et presque avant même de « penser aux filles », je sautais d’aussi bon cœur sur les petits plats de ma mère que sur toutes ces choses dont les pages se tournent et qu’on nomme des livres, et aussi des revues et des magazines. Des choses qui foisonnaient autour de moi. Il suffisait de se baisser, de les ouvrir. Je les avais à portée de la main et des yeux en collections entières chez certains professeurs ou parents de mes camarades de classe de ce lycée bien particulier où j’eus la chance de passer le plus clair d’une adolescence bienheureuse, et où m’a été comme inoculé un sérum du plaisir qui m’en a donné le goût pour la vie entière.
C’est ainsi, c’est alors, que je découvris dans les piles des magazines Vu le magazine de Lucien Vogel, ou de Regards, (la revue communiste d’avant Paris-Match), les photographies justement, de Doisneau, Willy Ronis, de Brassaï, Henri Cartier-Bresson, d’un David Seymour qui n’était pas encore «Chim», Izis, Man Ray, Munkàscy, d’Erich Salomon (ce « Roi des Indiscret»que j’exposerai un jour, bien plus tard), de Robert Capa et même celles sans doute aussi de cette Gerda Taro, sa camarade de lit et de combat dont l’histoire de la «valise mexicaine» miraculeusement retrouvée, vient tout juste de me rappeler que j’ai sans doute du la croiser à l’époque. Elle, assurément pas, mais en tout cas, ses photographies.
Je me souviens, comme si c’était hier, du véritable choc qu’avait été pour moi la découverte des deux Cartier-Bresson publiés par Tériade aux Editions Verve. Une révélation, quand j’y repense. A quoi tient parfois, « un chemin de vie » pour ne pas parler de vocation. Leurs couvertures aussi joyeuses et lumineuses l’une que l’autre, étaient signées de Matisse, pour Images à la sauvette et Miro pour Les Européens. J’en retrouve l’odeur de l’encre, le souvenir intact des noirs profonds et chauds de l’impression des photographies que je m’attacherai plus tard à retrouver. Cela se passait dans une villa de la Traverse Saint Nicolas sur les hauteurs du Roucas Blanc à Marseille qui appartenait aux parents fortunés d’un camarade de classe du nom d’Antoine Cordesse. Un rêveur passionné de mathématiques, disparu bien trop jeune, et dont je devais rester l’ami quand sa famille et moi, montâmes à Paris. Il allait bientôt épouser la dame qui présidera les Rencontres d’Arles, puis la Fondation Lartigue. Elle s’appelait Maryse, comme sa belle-mère à laquelle je continuais à rendre visite bien après la mort de son fils.
Faute de pouvoir m’offrir les Cartier-Bresson de Tériade, je me rabattais sur les livres que commençaient à publier de plus en plus d’éditeurs comme Les Arts et Métiers Graphiques, la Guilde du Livre à Lausanne ou Robert Delpire... J’achetais aussi quelques numéros de Bizarre la revue de Jean-Jacques Pauvert, ou de vieux exemplaires de Vu ou de Regards, davantage dans mes moyens. Je me souviens entre autres d’un livre de Brassaï, Séville en fête et d’un autre sur « Paris des Rêves » de Izis.
Fort peu de chose me restent de cette époque-là. L’inventaire en est vite fait : un numéro spécial d’une belle revue Le Point (rien à voir avec l’hebdo) où Picasso est photographié par Doisneau et un autre de la revue Bizarre de Jean-Jacques Pauvert dans lequel le même Doisneau nous fait entrer dans l’univers du Facteur Cheval.
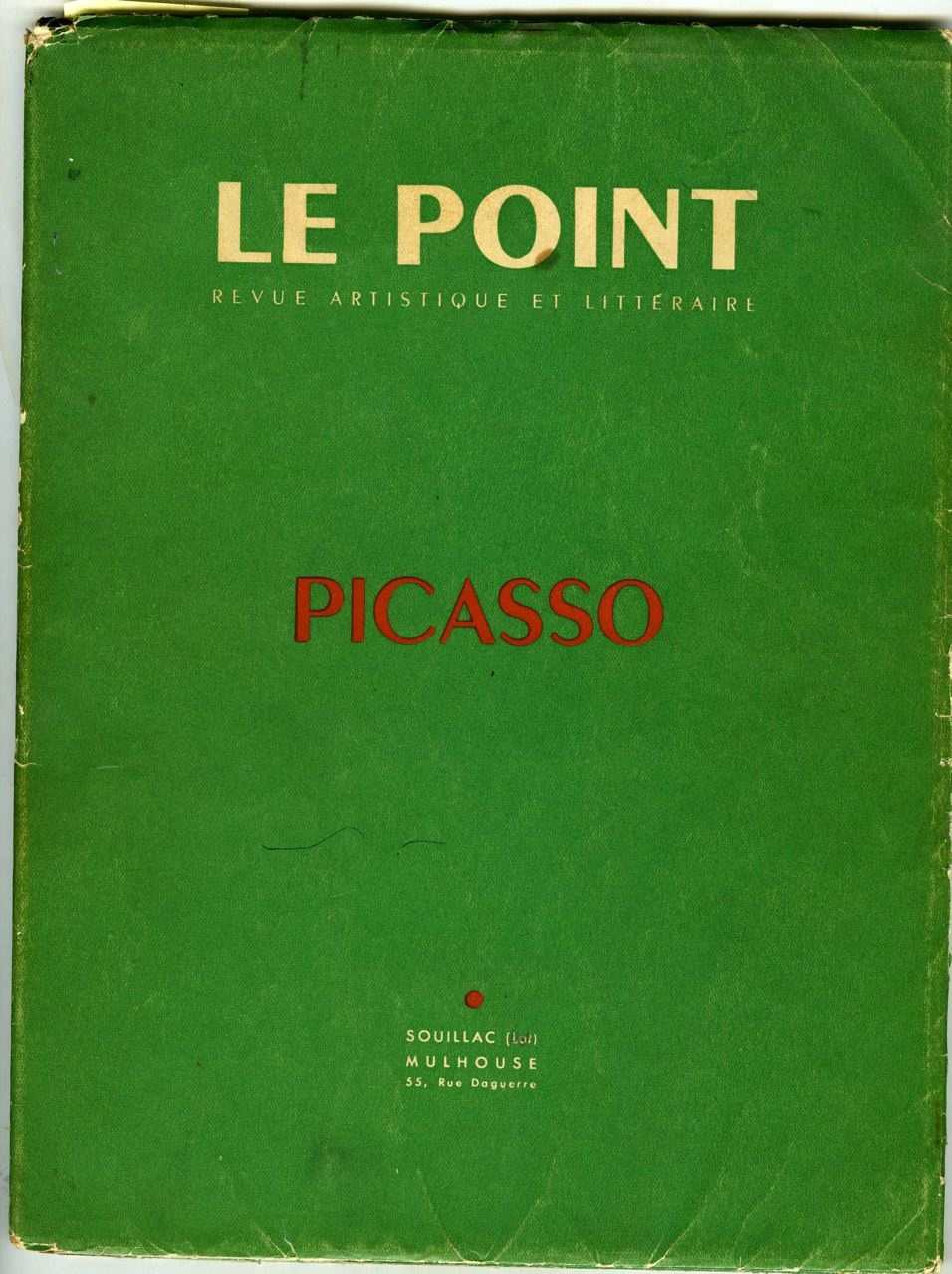

Une bonne douzaine d’années plus tard, ce numéro de Bizarre me vaudra avec Guy Bourdin, un de ces engouements soudain sans trop de lendemain qui semblait pourtant bien parti pour être des amitiés au long cours. J’en garde précieusement l’unique et fort belle épreuve en noir et blanc d’un arbre qu’il m’offrit généreusement. C’est une cépée, un bouquet de saules argentés dont au compte-fil, on peut distinguer les nervures de la moindre feuille se détachant sur un ciel pâle. Ce contact en 18 x 24, date du temps où Bourdin aimait travailler à la chambre. Pour son seul plaisir.
Allez savoir pourquoi, les « amateurs », les acheteurs, ont de tout temps préféré ses images en couleurs. Quand je lève les yeux de mon écran tactile, je peux la voir, près d’une autre photographie représentant des arbres blancs et calcinés de la Terre de Feu. Celle-là me reste d’une autre rencontre aussi belle et éphémère avec un autre grand de la photographie : Sergio Larrain dont je devais publier l’ultime portfolio.


Mais me voilà encore repartis dans d’autres temps et d’autres histoires. Et je voudrais bien éviter de vous égarer davantage dans les méandres d’une vie qui part pour être déjà passablement embrouillée. Il faut dire qu’à l’époque dont je vous parle, de mon retour d’Algérie en 1956 au bon milieu des années 60, j’aurais bien d’autres choses à penser que la photographie. Sans m’être tout à fait tombée du cœur, elle m’est, disons, sortie de la tête. Et pour le photographe que je ne rêve plus d’être, notre coup de foudre, notre relation n’a été qu’une passade, une affaire sans lendemain. Il est temps de m’occuper de ce qui va être le seul, le vrai rêve de ma vie : le cinéma.
Sorti sans grands dommages de trop longs mois gâchés dans la guéguerre d’Algérie, j’étais revenu à Marseille, où je fus un moment retenu. Le temps de rencontrer l’Amour, la « femme de ma vie ». La première nuit que je passais avec elle, je découvris qu’on pouvait avoir un bras de trop. Un cœur de trop, lorsque bientôt, sans crier gare, elle me quitta. L’extraction douloureuse d’une dent de sagesse me fit oublier quelque peu, mon chagrin. Je pris la fuite et je me retrouvais bientôt lâché dans Paris, tel un jeune chien fou qui va et vient à perdre haleine dans son nouveau terrain de chasse. Le nez au vent, le cœur en bandoulière, je me lançais à corps perdu sur toutes les pistes et les chemins, que le destin voulait bien me frayer.
Le cinéma était loin d’être la terre promise imaginée de loin. Des rencontres, des espoirs, des promesses... Mais aussi des projets sans intérêt sinon sans lendemain, et à défaut quelques opportunités qui «dépannent»: des figurations, des désillusions et des déconvenues... Jusqu’à la faim même, une fois. C’est donc ça, le cinéma de mes rêves ? Qu’importe !... J’ai en moi une patience infinie et une certitude, une foi, propre à me consoler de bien des déceptions... Pour quelques semaines auprès d’un Dassin ou d’un Cavalcanti, d’André Michel, de Philippe Agostini, combien d’autres passées en pure perte auprès de bien plus de faiseurs de films tout juste bon à vous faire répondre à qui vous demande «Où avez-vous appris votre métier ? Auprès, tant bien que mal, de ceux qui ne le connaissaient pas.» Faute de réalisateurs estimables et dignes d’être accompagnés, je devins l’assistant et l’ami proche d’un homme qui devait être pour moi un mentor et un passeur.
Mayo, (de son vrai nom Malliarakis) était arrivé dans ma jeune vie, je le compris plus tard pour m’ouvrir l’esprit et les yeux sur les choses et les hommes. Grec né au bord du canal de Suez, était ce que j’appellerais un humaniste, un uomo di cultura. Passé par le surréalisme, c’était un peintre à l’ancienne qui savait tout de la fabrication et du mariage des couleurs et pouvait vous parler de la palette propre à chaque peintre ; dessinateur hors pair, il avait illustré La Peste de Camus, les poèmes de Prévert ; décorateur et surtout costumiers il avait habillé les Enfants du Paradis, les Visiteurs du Soir, Gervaise et Casque d’Or. Je l’assistais en cas de besoin, pour l’ultime film de Carné, le premier de Michel Drach, un autre d’André Michel. Mais c’était peu fréquent et il valait mieux trouver quelque autre expédient.
Quand je me repasse le film de la vie du jeune homme que j’étais alors, il me revient la petite musique de ces vers d’Eluard que je sais «par cœur», comme on dit joliment :
C’est la chaude loi des hommes
Du raisin, ils font du vin,
Du levain, ils font du pain,
Des baisers, ils font des hommes.
Vingt ans, à en croire Nizan, n’était peut-être, pas « le plus bel âge de la vie », mais pour moi, c’était ne lui en déplaise, celui de tous les possibles.
Il s’en fallait d’un défi, d’un pari entre copains pour que j’écrive en tout juste dix jours, un polar à succès publié par la Série Noire. Pour que d’un lieu, découvert par hasard, je fasse un restaurant à nul autre pareil où le Tout-Paris, la « cour et la ville » du monde entier allaient bientôt se donner rendez-vous. Il faut dire qu’il portait le nom d’un parrain qui facilitait bien des choses : L’Atelier de Maître Albert, le grand alchimiste dont la statue se dressait dans le temps sur sa place Maubert.
Alors, comme une coquette vainement courtisée qui se repent un beau matin, de vous avoir fait tirer la langue, le cinéma se rappelait soudain à mon bon souvenir. De mon roman on tirait un film. Roman Polanski en faisait l’adaptation, et Guy Bedos et Sophie Daumier en étaient les vedettes. Les producteurs m’appelaient... Les portes s’ouvraient... Les projets, les scénarios affluaient, à écrire, à co-écrire, à réparer... Mes éditeurs, Marcel Duhamel, les lecteurs réclamaient la suite du polar... Je pouvais appeler Chris Marker, Alain Resnais, Pierre Kast, dont j’avais été l’assistant pour son court métrage sur Le Corbusier, qui me suggérait un titre anglais pour La Crimerie, ma deuxième Série Noire : «The Murdergarten», amusante allusion au Kindergarten.Queneau même, « le dénommé Queneau, Raymond de son prénom », qui voulait bien discuter avec moi du scénario de «Pierrot, mon ami» que je nous proposais, à lui et moi, de faire .
C’était un temps, il est vrai, où tout semblait en tout cas plus facile. Il suffisait souvent d’oser taper aux portes… qui s’ouvraient. «Et la photographie, dans tout ça ? »,me direz-vous... « À vous écouter, nous en voilà bien loin! »
Bien moins que vous ne le pensez ; moins que je ne l’imaginais, moi-même... Loin d’avoir renoncé à ce qu’on pourrait appeler « notre flirt, notre amourette de jeunesse », la photographie n’entendait pas me perdre comme ça. Elle n’allait pas me quitter d’une semelle... Telle une fille, une laissée pour-compte, qui n’a pas dit son dernier mot, elle ne faisait que me laisser vivre à ma guise, bambocher, tout en m’ayant à l’œil. Comme si elle était sûre de m’avoir au tournant. Et quand j’y repense, j’ai le sentiment d’avoir été pendant ces sept ou huit années, rien qu’un de ces chiens qui se croient libres au bout de leur laisse extensible. L’air de rien, discrète, la photographie avait l’art d’être toujours là pour me faire retomber, comme par hasard, au moment propice, sur ces photographes dont dans le temps, tout jeune, j’avais découvert les images.
Elle était là, par exemple, en 1956, quand Tristan Tzara, le « père du Dadaïsme », me faisait rencontrer Man Ray et sa femme Juliette, dans leur atelier de la rue Férou. C’est grâce au même Tristan Tzara que je devais aussi tout apprendre sur Adolph Loos, le prodigieux architecte et théoricien viennois d’avant-garde, qui avait construit pour lui, sa maison particulière de l’avenue Junot à Montmartre où j’étais allé le chercher et que l’on peut voir encore.
Petit détail amusant : c’est Adolph Loos qui avait décoré la boutique de Knizé, le tailleur-parfumeur viennois des années 30, dont il avait aussi conçu l’image et l’étiquette du parfum qui se trouvait alors dans la boutique à la même enseigne de l’avenue Matignon. Un parfum que j’y achetais à l’époque et auquel je reste fidèle depuis plus de 50 ans.
La photographie, pour en revenir à elle, rôdait encore dans les parages et m’attendait de pied ferme, quand j’écoutais à la Coupole, Brassaï et Mayo évoquer leurs souvenirs sur le Montparnasse de leur jeunesse, la Villa Seurat, l’Egypte du Canal, la Grèce de Lawrence Durell et surtout d’Henry Miller auxquels ils avaient inspiré l’un et l’autre, des personnages de romans : Mayo, Le Colosse de Maroussis et Brassaï, Max et les Phagocytes.
Elle était là, toujours là, à la même époque, quand, assistant de Jules Dassin dans son film, La Loi, je me prenais de sympathie avec Arturo Zavattini, le cameraman du film, guère plus âgé que moi, dont le père, Cesare Zavattini, scénariste et écrivain en renom venait justement de faire avec Paul Strand, un fort beau livre sur un village de la plaine du Po. Un paese. Ils m’en avaient offert et dédicacé tous deux, un exemplaire que je garde d’autant plus précieusement que je faillis le perdre. Glissé entre deux autres livres, il avait échappé par miracle à l’incendie dont nous avions été victimes. Seule la couverture à demi cramée, brunie, avait souffert que je pus échanger contre celle d’un exemplaire en bon état. Il m’en a coûté un exemplaire des Américains de Robert Frank. Il faut savoir faire, parfois, la part du feu.



J’avais connu Paul Strand quelques années plutôt, en 1953, ou tout début 54. Mais à l’époque, aussi curieux que cela puisse paraître, j’ignorais tout, ou presque, du photographe qu’il était. Les films documentaires et politiques, comme Les Révoltés d’Alvarado, dont je le savais le réalisateur, en faisaient à mes yeux un de ces cinéastes américains victimes du maccarthisme, avec lesquels je manifestais devant l’ambassade des Etats Unis contre la guerre de Corée, du Vietnam ou la grâce des Rosenberg. C’était John Berry, Dalton Trumbo, Joseph Losey que j’étais appelé à revoir, et dont il faudra que je vous reparle. De Paul Strand aussi d’ailleurs, et de sa femme Hazel. C’est d’elle que j’appris la recette de la tarte à la noix de pécan, c’est de John Berry, que je tiens goût des tartines de peanut butter (le beurre de cacahouète) assaisonnées à la marmite, (prononcez -maïte- à l’anglo-saxonne) : ce concentré noir de légumes pouvant servir de bouillon Kub.
Et puis, plus de quatre années passèrent sans que la photographie me donne le moindre signe de vie. A croire qu’elle m’avait oublié ...
Peut être, après tout s’était-elle fait une raison, à me voir dans un tel tourbillon de choses à faire et de projets: un nouveau roman à écrire, le restaurant tout juste ouvert qui ne désemplissait pas et occupait le plus clair de mes nuits... Sans parler du cinéma me sollicitant de plus belle....
Mais c’était mal connaître notre entêtée. Loin d’avoir dit son dernier mot, elle allait bientôt revenir à la charge et me prendre par surprise au moment, et là, où je l’attendais le moins...
Elle eût la partie belle. J’avais la tête et le cœur ailleurs, j’étais distrait, et mon existence déjà bien remplie, ne m’avait pas empêché de tomber follement amoureux d’une fille qui - Ô comble de la séduction - ne voulait pas entendre parler de moi. Je ne sais même plus combien de fois, il me fallut me présenter à elle, et me représenter... Et d’une fois sur l’autre, elle semblait, le plus innocemment du monde, avoir oublié jusqu’à mon nom. C’est ainsi que trois amis, purent se flatter d’avoir été celle ou celui qui nous avait présentés l’un à l’autre et mariés.
Lorsque je lui demandais sa main, j’étais loin, très loin d’imaginer un seul instant, que cette demoiselle fraîchement débarquée de sa Corse natale, pouvait être la belle-sœur d’un certain Walter Carone qui, non content d’être un photographe en renom et le directeur de la photographie de Paris-Match, caressait à temps perdu, l’idée d’un nouveau magazine qui s’appellerait PHOTO et dont la devise « les professionnels au service des amateurs » était déjà pour lui, tout un programme.
J’ignore pourquoi, cinquante ans après, j’ai tant de mal à revenir sur ce passage en particulier, sur cet instant charnière de ma vie et le virage qu’elle me fit alors prendre à la fois sans que je le veuille vraiment et en me prenant pour complice. Tout n’était pourtant pas aussi embrouillé que je veux bien le dire aujourd’hui. Les choses allaient plutôt d’elles-mêmes. Sous le désordre apparent du cours qu’elles prennent se cache souvent la simple réalité de ce qu’il nous est donné de vivre. Même si parfois ce n’est pas de gaîté de cœur.
Dans le cheminement, le cours « chaotique » de ma vie (pour parler comme un mathématicien), ce milieu des années 60 m’apparait aujourd’hui comme un de ces moments essentiels d’une existence constamment ballotée, sans que souvent j’en ai conscience ou le veuille, entre le hasard et la destinée. Entre ce qu’on pourrait appeler, le self-arbitre et le serf-arbitre.
Ce n’était ni la première fois ni la dernière fois que je devais avoir ce sentiment, cette certitude de devoir aveuglément « collaborer avec mon destin » pour emprunter la formule éclairante de l’écrivain canadien de langue anglaise, Robertson Davies.
Vues avec le recul les choses étaient pourtant claires. Apparemment, du moins. Et je pourrais très bien me contenter de vous raconter comment le jeune auteur d’un best-seller, le restaurateur à succès, le cinéaste qui perçait en moi, allait devenir du jour au lendemain, un journaliste de métier, prêt à consacrer quelques trente années de son existence à la photographie.
Mais ce serait oublier plusieurs détails qui eurent aussi leur importance, tels que le mariage d’abord dont je vous ai parlé et une épouse qui en eût bientôt assez des journées sans relâches et des nuits par trop blanches qui étaient les miennes et qui me fit bientôt vendre ce restaurant en pleine ascension. Je le sacrifiais d’autant plus volontiers qu’il n’était au fond pour moi, qu’une sorte de reniement.
Il faut que vous sachiez qu’à l’âge des « juré-craché », quand j’avais à peine dix-huit ou dix-neuf ans, les deux choses auxquelles je m’étais promis de ne jamais toucher de ma vie entière, était — allez savoir pourquoi ! — la restauration et le journalisme.
L’une, parce que le comble de l’horreur et de la vulgarité était à mes yeux de jeune dandy plein de morgue, de passer sa vie à regarder des inconnus s’empiffrer et mâchouiller toutes sortes de mets et de vins en parlant d’autres choses ; l’autre, parce que la plupart des journalistes, n’étaient à mes yeux que tout un tas d’encyclopédistes ignares et de rouletabilles serviles et culottés qui lorsqu’on les mettait à la porte entraient par la fenêtre. Le comble étant pour moi, les reporters de Paris-Match.
Le démon malicieux qui m’avait déjà poussé à créer l’Atelier Maitre Albert, le premier des nombreux restaurants que je devais ouvrir, n’en n’avait pas fini avec moi : il entendait me voir me renier pour la deuxième fois. Le coq que je suis pour les astrologues chinois ne pouvait que déchanter.
Mais ce n’était pas tout. Et il s’en fallut encore d’un détail d’importance que j’aurais garde d’oublier. Comme pour me consoler du restaurant qu’elle m’avait forcé à vendre, mon épouse tomba enceinte. Un enfant, un fils devait bientôt voir le jour. La grossesse coïncida avec la préparation du magazine auquel je m’étais finalement résigné à collaborer « le temps de voir et faute de mieux ». Le numéro UN du magazine PHOTO sortit en été 1967 peu de mois après la naissance d’un garçon.
