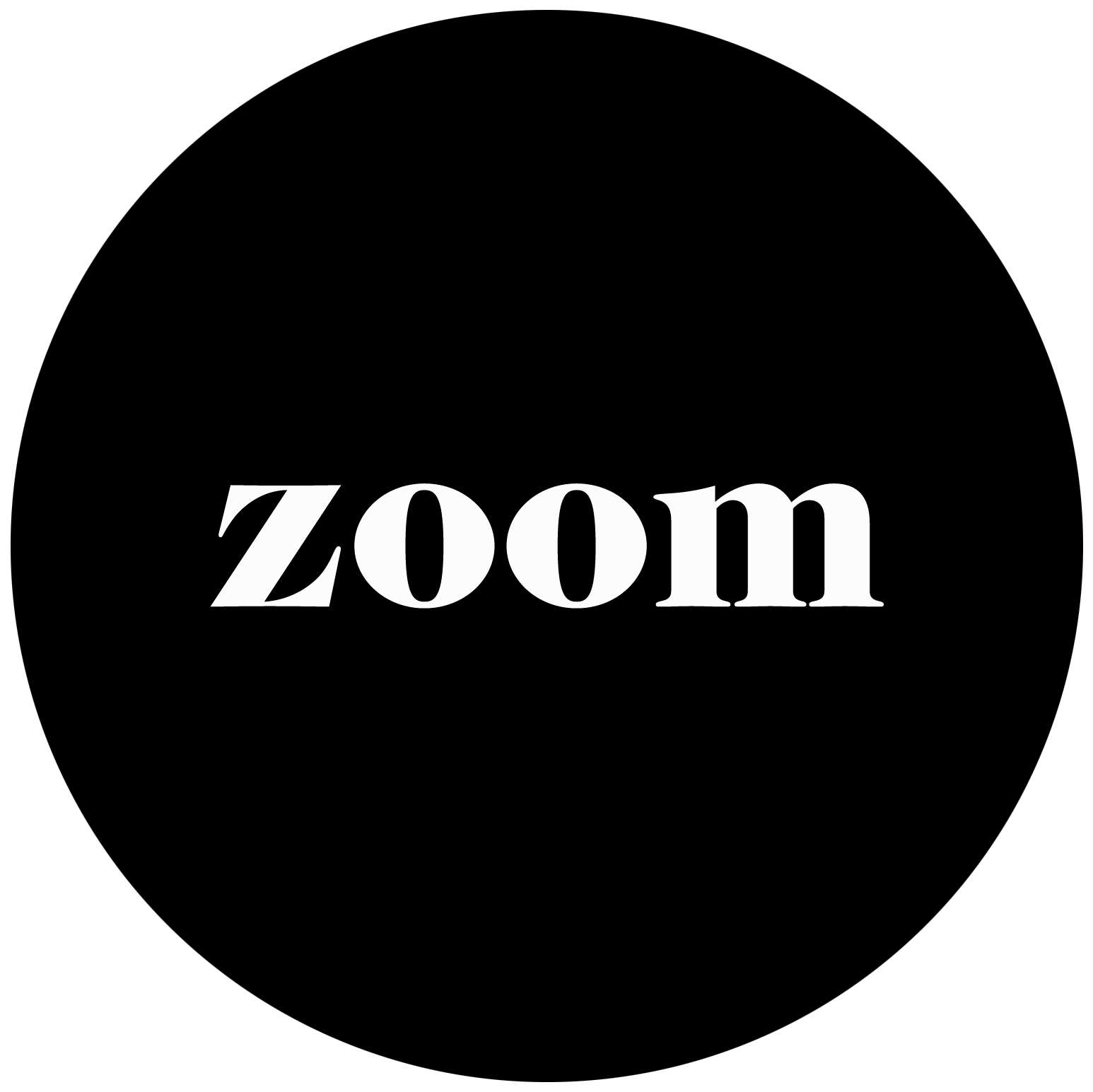
Le zoom de décembre 2024 avec Gaston Pineau
L’Entretien,
La résurrection : nouvelle histoire d’une voie initiatique
par Christine Delory-Momberger et Valentin Bardawil
Note des auteurs:
“Pour ceux qui ne connaissent pas Gaston Pineau, il est une figure des histoires de vie mais aussi de la formation des adultes. « Il a rayonné au sein des associations de chercheurs et de praticiens-chercheurs en histoire de vie, au sein de l’Université où il a contribué à la création de masters en formation continue, ceci en connivence avec des mouvements d’éducation populaire dans une logique d’émancipation et de partage des savoirs, dans la co-formation internationale ». (D. Bachelart)
Il a été responsable de recherche à la Faculté de l’Éducation permanente de l’Université de Montréal de 1969 à 1985, puis professeur à l’Université François Rabelais de Tours en Sciences de l’Éducation et de la Formation jusqu’à sa retraite en 2007, il a vécu en alternance entre Tours et Montréal, en contribuant à construire un nouvel espace francophone de la formation permanente. Depuis 2014, il est chercheur émérite au Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’Ère) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Alors pourquoi publier un entretien avec cet homme dans une rubrique réservée à la photographie?
Tout simplement parce que nous avons été invités tous les deux au mois de mai de cette année 2024 avec Gaston Pineau à donner des conférences au colloque international de recherche biographique (CIPA) à l’UNEB (université de l’État de Bahia) au Brésil et c’est lors d’une discussion que nous avons eue en marge de cette manifestation à propos du travail que nous menons dans l’Observatoire des Nouvelles écritures de la photographie documentaire que Gaston Pineau a soudainement parlé de « résurrection ».
Nous y avons été tout de suite particulièrement sensibles car Christine Delory-Momberger avait publié quelques mois auparavant dans le journal 9lives, un entretien intitulé « D’une image à l’autre, histoire de résurrection » et Valentin Bardawil avait présenté une performance lors du dernier Banquet des Vivants intitulée « Le filicide, un projet d’avenir… » dans laquelle il proposait quelques jours avant les fêtes de fin d’année 2023 de « ressusciter » en public.
La question de la résurrection nous était donc familière mais avec l’intervention de Gaston Pineau, elle prenait un tour plus élargi à dimension politique. Pourquoi lui aussi se sentait-il concerné par cette notion qui est le fondement de la croyance judéo-chrétienne?
Fallait-il la mettre en lien avec le désordre mondial et l’ère de l’Anthropocène qui remet en question notre manière d’appréhender le monde?
Ce qui était certain, c’est qu’à une époque où, comme le dit l’écrivain François Meyronnis «l’instantanéité des réseaux engendre une déstructuration du temps linéaire qui reposait jusque-là sur la succession du passé, du présent et du futur et qui est court-circuité par «l’instant- spectacle» qui résulte de l’instantanéité cybernétique»,il était indispensable de se questionner sur la prégnance de la résurrection dans la construction intime de l’individu.
Nous avons proposé à Gaston Pineau de faire un entretien pour aller plus avant dans l’élucidation de cette énigme…
Christine Delory-Momberger et Valentin Bardawil: Lors de nos discussions ces derniers jours, tu as partagé avec nous ta sensibilité à la question de la résurrection et à tes liens avec Jésus et la Galilée. Peux-tu nous dire ce qui t’intéresse tant dans cette histoire ?
Gaston Pineau: Pour moi Jésus est avant tout est un grand frère. J'ai d’abord essayé de le rencontrer à Nazareth où il est né. Il est le fils d’un charpentier comme moi et je trouvais que c'était le modèle, le compagnon avec lequel je pouvais me construire.
VB: À quel âge as-tu eu le sentiment d’entrer en lien avec Jésus?
GP: Une des premières paroles qui a été importante pour moi, c’est : «L'homme ne vivra pas seulement de pain» (Matthieu, 4,4). Il faut comprendre que je suis né dans un milieu de villageois. Mon père était forgeron et charpentier et il n’y avait aucun livre à la maison. En termes de «Lettres», j’avais seulement accès au calendrier des PTT sur lequel était inscrit une devise de la paroisse qui changeait tous les mois. Celle qui m’a particulièrement marqué dès j’ai pu commencer à lire était tirée de l’évangile selon Saint Matthieu, elle disait : «L’homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu». L’atmosphère de notre village était à la fois laborieuse et conviviale, de grandes discussions engagées se tenaient régulièrement autour de la place principale que la religion, les curés et la République occupait dans nos vies. Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre mais les discussions restaient toujours conviviales. Moi de mon côté, je me disais que si le Charpentier n'était pas venu sauver ce quotidien laborieux, c’est qu’il avait loupé son coup. Ce « quotidien des masses » me travaillait et bien plus tard à l'adolescence, je suis tombé sur un livre de René Voillaume, Au cœur des masses[5], il venait de la congrégation Les Petits frères de Jésus qui voulait vivre la vie du charpentier au cœur des masses. C’est avec ce livre que j’ai compris où était ma voie et à vingt ans, je suis parti rejoindre cette congrégation.
Avant de rentrer chez eux, il fallait faire un noviciat dans le Sahara comme le Père de Foucauld, mais comme cela se passait pendant la guerre d’Algérie et qu’il y avait deux ou trois gars qui s’étaient déjà fait tuer là-bas, ils nous avaient envoyés dans un coin désertique du nord de l’Espagne, dans des grottes qui avaient été creusées pendant la guerre civile et qui ne servaient plus. On travaillait en alternance la solitude du désert et comme « péon », comme « paysan » avec les habitants. C’était l’apprentissage du désert et du cœur des masses en faisant évidemment la liaison entre les deux parce que quand tu es habitué au désert, tu n’as plus envie d’aller travailler avec les gens. C’était une alternance très rude. Ensuite j’ai été appelé à l’Armée pour l’Algérie. Je ne voulais pas y aller mais les objecteurs de conscience risquaient à l’époque jusqu’à cinquante ans de prison. Comme j’avais eu mon baccalauréat, je pouvais rester six mois supplémentaires en France et entrer d’office dans les classes de sous-officiers. J’ai refusé leurs propositions mais pour montrer que je ne faisais pas cela par lâcheté et toujours dans l’idée de rester au cœur des masses, je suis parti en même temps que mes camarades comme deuxième classe, en demandant d’être infirmier parachutiste pour ne pas avoir à tirer sur les Arabes.
Christine Delory-Momberger: Combien de temps exactement es-tu resté en Algérie?
GP: Deux ans… J’ai vingt-quatre ans quand je quitte l’Algérie et je retourne dans ma congrégation chez Les Petits frères de Jésus. Cette année-là se passait à Annemasse et à Genève pour entamer des études de philosophie. J’avais déjà fait l’apprentissage du désert et des masses, je devais maintenant faire l’expérience des études. Il y avait une première année de philosophie que j’aurais pu suivre mais à ce moment-là j’étais extrêmement sceptique sur la valeur de l’intelligence. On est en 1964 et à l’époque je ne croyais pas au travail intellectuel, je voyais le Salut du monde par le travail manuel, comme le Charpentier. C’est en découvrant la pensée de Sartre que je prends conscience que chaque être et chaque chose ont une valeur et que je me réconcilie avec l’intelligence que j’associe alors à une forme d’être au monde. Mais manque de chance, alors que je commençais à me sentir comme un roi, on m’annonce durant les fêtes de Pâques qu’il va falloir que je quitte la congrégation. Ils en étaient arrivés à penser que je serais mieux ailleurs, que je ne pourrais pas m’épanouir chez eux. Ils m’ont demandé de partir mais m’ont proposé de me laisser le temps pour que je puisse m’organiser. Cette sentence a signifié pour moi le début d’une descente personnelle sous terre.
CDM: Ils ont justifié pourquoi ils voulaient que tu partes alors que tu te sentais heureux là-bas ?
GP: Je ne me souviens plus des raisons qui m’ont été données mais je me rappelle qu’on était à Pâques et qu’à cette annonce, je suis allé m’enfermer. Pendant ma méditation, une phrase m’est revenue que le Christ a dit à ses disciples après la résurrection : « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une force venue d’en haut. » (Luc, 24,49)
J’ai médité avec cette phrase pendant cinquante jours jusqu’à ce qu’à la Pentecôte, je sente tout à coup une grande paix m’envahir sous la forme d’un courant d’air qui est venu me traverser. J’avais vraiment le sentiment d’avoir passé plusieurs semaines, enfermé au fond d’une cave dont je ne trouvais plus l’escalier de sortie et à un moment donné, me sentant épuisé d’avoir fait le tour de cette impasse intérieure, je me suis abandonné. C’est à ce moment-là que j’ai senti ce courant d’air passer. J’ai été tout de suite ré-énergisé et habité par cette force d’en haut, j’ai pris la décision de quitter la congrégation. Je venais de vivre ce que j’ai appelé ma « résurrection » et qui, contrairement à ce que certains comprennent dans ce mot, allait amorcer pour moi une longue période de quête existentielle. Mon problème principal était de trouver un autre endroit où aller. J’avais même oublié que l’université existait parce que j’étais devenu un ouvrier agricole, je m’étais incarné en pioche pour trouver le meilleur coup de pioche à donner dans les travaux avec la terre.
Je quitte donc Annemasse en me disant que j’allais devenir forgeron/charpentier comme mon père. On était alors au passage du monde agricole au monde urbain et on appelait cela « mécanicien agricole ». C’était un métier très recherché et je n’ai pas trouvé de formation libre. Seules des formations de maçonnerie moderne ou de ferronnerie d’art étaient disponibles. J’aurais bien aimé aller vers la ferronnerie d’art mais je ne voulais pas travailler pour les bourgeois, je me suis donc décidé pour la maçonnerie. Et me voilà parti en auto stop pour Tarbes, une petite ville du sud de la France pour suivre une formation qui devait commencer en septembre. Sur le chemin, je m’arrête à Nantes pour rendre visite à ma famille. Mon père me fait cadeau d’un vélo et c’est en deux roues que je débarque à Toulouse pour rejoindre un copain avant de commencer ma formation. Mes parents, inquiets pour moi, me propose de les rejoindre à Lourdes où ils avaient prévu d’aller pour le 22 août et je décide de les rejoindre. J’arrive à Lourdes avant eux, toujours sur mon vélo mais malgré le « courant d’air » qui m’avait permis de sortir de ma « cave », je me sentais de plus en plus au fond du trou. Je n’étais pas sorti de mes profondeurs.
Le soir de mon arrivée dans cette ville de pèlerinage, en remontant à pied une côte un peu rude en tenant mon vélo sur le côté, je me suis senti au bout de mon rouleau, à bout de force. La guerre d’Algérie me travaillait et j’avais véritablement l’impression de devenir fou. Je pensais que si je ne rencontrais pas quelqu’un avec qui dialoguer, il fallait mieux me flinguer. En arrivant en haut de la côte, il devait être environ onze heures du soir, je vois un écriteau sur lequel était inscrit « Centre de rencontres internationales ». Je décide de m’arrêter pour y passer la nuit. Le centre était plein mais on me propose de m’installer dans le garage dans lequel il y avait des hamacs suspendus. Et c’est là que je découvre le mouvement Pax Christi.[6]
À cette époque, on était nombreux à être tourmentés par la guerre d’Algérie et à la suite de discussions sur ce sujet, de jeunes étudiants me conseillent d’aller voir leur responsable.
VB: Quelle était la nature des questions que tu leur posais?
GP: Elles portaient essentiellement sur la violence et la non-violence. Faut-il répondre à la violence par la violence? On était fin août, mon stage de maçon commençait le 10 septembre et je n’avais pas d’endroit où aller. C’est en parlant avec le responsable qu’il me propose de rester quelques jours et de participer à la vie du centre. Je me joins à une petite équipe de jeunes et c’est ainsi que je découvre qu’il existe des étudiants en psychologie et en géographie.
Un nouveau monde s’ouvrait à moi mais j’avais atterri dans une auberge de jeunesse qui n’était qu’un lieu de passage dans lequel on ne restait que quelques jours. Au bout d’une semaine, on me propose de participer à la fondation d’une formule plus longue de rencontres à Barèges, une station de ski située à 1200 mètres dans les Hautes-Pyrénées. Cette fondation nécessitait de rassembler un petit groupe de jeunes pour aménager une grosse bâtisse qui n’avait jamais été occupée l’hiver. Il était prévu qu’on fasse du ski et que le soir, il y ait des cessions de réflexion pour apprendre à se connaitre et traiter des problèmes de paix.
Je m’étais promis de ne pas m’embarquer dans ce genre d’expériences au moins pendant un an. Ma formation de maçon commençait en septembre où il était prévu que je sois nourri logé et que je dispose même d’un peu d’argent de poche. C’était parfait pour moi. Au moins je saurais qui je suis : un maçon moderne. Mais après réflexion, je me suis dit que c’était quand même une occasion à ne pas laisser passer. Si cela tournait mal, je pourrais toujours retrouver un stage par la suite.
VB: Tu vis quand même une sorte de miracle à Lourdes, en y trouvant la réponse à une demande qui était existentielle pour toi à ce moment-là?
GP: Absolument, je suis donc parti pour Barèges avec quatre autres gars, deux de dix-huit ans, un autre de vingt-cinq ans comme moi et le responsable qui en avait trente. On a aménagé le grand bâtiment qui pouvait accueillir cent personnes. On l’a appelé L’Hospitalet. On a installé le chauffage, c’était un gros boulot. Le responsable avait fait les Beaux-Arts, il savait à peu près qui il était et il nous a demandé de choisir notre voie professionnelle. Encore cette maudite question ! J’ai pensé à être journaliste pour continuer à courir et explorer le monde. Mais c’était complètement utopique, non seulement je n’avais jamais rien écrit de ma vie mais j’avais aussi perdu la pratique de l’écriture. J’ai demandé à mon collègue qui avait le même âge que moi ce qu’il voulait faire, il m’a parlé de géographie. Il y avait un petit centre universitaire à Pau, pas loin de là. Je lui ai demandé si on faisait aussi du français. J’ai décidé de l’accompagner en pensant que cela pourrait toujours me servir.
En arrivant, je découvre un écriteau qui portait l’inscription : « Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ». Si les Lettres ne me disaient rien, les sciences humaines m’interpellaient, j’y voyais un moyen de me comprendre. La première année était un tronc commun et on s’est inscrits tous les deux dans le même cursus qui proposait du latin, de la géographie et de la philosophie. On est tombés sur un bon professeur de philo qui nous a fait lire les textes fondamentaux. Il me dira à la fin de la première année : « Pineau, vous avez un style rocailleux mais vous avez quelque chose. » Mais je devais gagner ma vie et je ne pouvais pas m’éterniser dans les études.
En parallèle de cette année en alternance avec l’université, on menait dans notre maison collective des sessions de réflexion. La première s’est déroulée à Noël, elle portait sur la non-violence. Le mouvement Pax Christi avait envoyé des étudiants de Paris pour animer la session mais la thématique de la non-violence, encore taboue à cette époque, s’est imposée malgré eux. Si on a gagné la bataille sur place, on a perdu la guerre et à leur retour à Paris, l’Hospitalet a été exclu du mouvement.
Au printemps, le mouvement cherchait un responsable pour gérer le Centre de rencontres internationales de Lourdes pendant l’été et j’ai été accepté en tant que petit nouveau pas encore trop compromis par les luttes internes. Mais il me fallait prévoir un avenir à plus long terme et j’ai écrit à Martin Luther King qui n’avait pas encore été assassiné. Je voulais aller étudier la non-violence avec lui en même temps que la psychologie que j’avais découverte grâce aux sciences humaines. Je ne sais pas s’il a reçu ma lettre mais je n’ai jamais reçu de réponse. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’aller étudier à Paris où il fallait habiter ou travailler pour pouvoir s’inscrire à l’université. Par chance, le mouvement avait besoin d’un emballeur dans la capitale et ils m’ont embauché. C’est comme cela que j’ai fait mon entrée en 1967 à Paris et à La Sorbonne.
CDM: C’est un chemin bien particulier que prend ton entrée dans un cursus universitaire… l’année à Pau t’a-t-elle donné une certaine stabilité dans ta voie ?
GP: Pau a été un tournant dans mon histoire, d’une part parce que c’est là que je découvre l’université et la voie formelle, ce que j’appelle la voie du « diurne ». Mais aussi parce que cette année-là, j’ai été amené à partager socialement avec un ami, ce que j’appelle « mon heure d’agonie », un repère que je continue à pratiquer tous les jeudis soir. La nuit de son agonie, le Christ dit à Pierre et aux deux fils de Zébédée pris de tristesse et d’angoisse : « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi ». (Matthieu, 26, 38) C’est ce que j’appelle la voie du « nocturne ». Et partager cette intimité avec mon ami qui m’accompagnait, ce n’était pas rien.
C’est donc vraiment à Pau que la double voie du diurne et du nocturne s’est imposée[7] même si elle avait déjà commencé après ma résurrection à Annemasse en 1964 puisque c’est à ce moment-là que j’ai commencé mon premier journal sur ces profondeurs qui m’habitent. Depuis, j’écris un cahier par an.
Il y a un autre repère important pour moi durant cette période, c’est Mai 68, j’ai compris à ce moment-là que je n’étais pas le seul à avoir des problèmes même s’ils n’étaient pas du même ordre. Les barricades quand on a connu l’Algérie et le baptême du feu, c’est un peu de la rigolade et à la fin du mois de mai comme tout restait bloqué, je me suis dit qu’il était temps que j’aille en Galilée. J’ai donc pris le premier avion qui y partait.
VB: La Galilée est le lieu d’origine des disciples, le pays où ils rencontrent Jésus mais c’est aussi après sa mort, à nouveau en Galilée qu’il leur donne rendez-vous pour faire l’expérience de sa résurrection. C’est cette rencontre avec le Christ que tu allais chercher là-bas?
GP: Oui, j’avais ce courant d’air qui m’avait traversé sans savoir d’où il venait, ni où il allait et j’espérais un « rendez-vous » avec le Christ. J’avais en tête la phrase qu’il avait demandé aux femmes de rapporter aux disciples après sa crucifixion : « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront » (Matthieu, 28,10). Je suis donc parti en Galilée pour vivre ce « rendez-vous » intime avec le Christ.
J’ai pu parcourir la région qui se ré-ouvrait après la Guerre des six jours mais rien ne m’a inspiré là-bas à part le lac de Tibériade qui restait le plus naturel avec une auberge de jeunesse dans laquelle je me suis installé. J’y ai rencontré un étudiant qui me dit : « Ici les pierres parlent. » Je me suis mis moi aussi à écouter les cailloux et j’ai eu le sentiment d’une présence personnalisante et inter-personnalisante. C’est à ce moment-là que j’ai pris la décision de me marier avec Françoise, la femme avec qui je partageais ma vie et avec qui je la partage encore aujourd’hui. Je lui ai envoyé une carte postale pour lui dire que j’avais une proposition à lui faire. On était au mois juin et en décembre 1968, nous revenions nous marier.
CDM: Vous vous êtes mariés à Tibériade?
GP: Oui et c’était magnifique parce que lors de mon premier voyage, j’avais découvert à Nazareth un petit centre français dans lequel je m’étais arrêté pour dormir et j’avais rencontré un jeune Arabe palestinien qui voulait apprendre le français pour partir de son pays et il m’avait accueilli chez lui[8]. On était devenus amis et je lui avais proposé d’être mon témoin. Fadel était donc notre témoin musulman et de son côté Françoise avait proposé à une amie israélienne de nous rejoindre. On avait réussi à réunir les trois religions…
Je n’ai jamais raconté cette histoire, sauf une fois en 1976 à une journaliste de l’AFPA[9] qui faisait un reportage sur l’alternance étude-travail et qui avait entendu parler de moi comme un gars qui s’était formé un peu bizarrement. C’était la première fois que quelqu’un me posait des questions sur mon parcours. Je lui ai raconté à peu près ce que je vous raconte. Mais elle ne savait pas trop quoi en faire. Et elle m’a demandé d’écrire un texte. Quelques jours plus tard, je lui ai envoyé cinq pages par la poste qu’elle m’a retournées en me disant que mon récit était trop sombre et que la vie n’est pas aussi noire. Elle pensait que cela me mettrait dans une situation de vulnérabilité si elle le publiait. D’après elle, un récit de vie comme le mien était irrecevable pour une revue professionnelle. J’avais intitulé mon texte : « Auto-formation et quotidienneté ». J’ai rangé mon texte dans un tiroir mais le mot auto-formation a réveillé quelque chose en moi.
VB: Tu me disais ce matin avant notre entretien que tu étais retourné en Galilée au moment de ton entrée à la retraite, nouvelle période à apprendre à vivre.
GP: Oui. C’était en 2008, quarante ans après, j’y suis allé en vélo cette fois-ci et Françoise m’a rejoint en avion. On a retrouvé nos deux témoins. Une boucle se terminait[10].
VB: Un cycle de quarante ans, ce n’est pas rien dans une histoire comme celle-là.
GP: Oui je n’y avais pas pensé… Le lac Tibériade est le lieu de l’apparition du Christ que les apôtres ne reconnurent pas tout de suite. Sentir une présence et la reconnaitre sont des choses différentes. C’est pour cela que je dis que la résurrection est un long processus.
CDM: C’est une patience ?
GP: C’est un long processus d’initiation, avec des ruptures, des transitions dont tu ne connais pas le terme tant que tu n’as pas parcouru le chemin. Je me trouvais dans ce processus d’être un marcheur aventureux et longtemps deux mondes ont vécu en moi en parallèle et même en contradiction. Après la retraite et mon premier voyage en vélo en Galilée, je suis parti, toujours sur mon deux-roues, faire les quatre routes du feu[11]. La première était la route des volcans, Vésuve, Etna, avec Empédocle, philosophe Sicilien du Ve siècle avant JC, le premier à voir les quatre éléments (air, eau, terre, feu) comme notre matrice cosmique. Puis j’ai fait celle des fours crématoires, Auschwitz, Sobibor et enfin la Terre de feu en Argentine.
VB: Où en es-tu de ta résurrection aujourd’hui ?
GP: L’hiver au Québec n’est pas tous les jours facile, surtout quand tu vis comme moi dans un chalet en pleine forêt. C’est pendant cette période d’isolement que m’est arrivée l’envie de raconter la vie d’un homme de mon âge qui parlerait de ce que c’est qu’apprendre à vivre le quotidien en octogénaire. À partir de quatre-vingt-cinq ans, l’énergie physique baisse et tu deviens davantage sédentaire que voyageur. J’ai commencé l’écriture d’un livre : Auto-éco-formation avec sept gestes élémentaires. Se réveiller. Se lever. S’habiller. Se déplacer. Se laver. Se soulager et Se nourrir. » qui sont les sept gestes matinaux[12]
Je me suis rendu compte en l’écrivant que les quatre éléments, l’Air, L’eau, la Terre et le Feu m’avaient beaucoup marqué. On oublie souvent qu’ils sont travaillés par les forces opposées que sont amour et haine. L’amour les réunit tandis que la haine les sépare. Pour moi qui aie bien connu les grands espaces et les longs voyages, devenir sédentaire pose un certain nombre de questions. Et c’est là que les quatre éléments sont revenus. Quand tu te réveilles dans un lit entre ciel et terre, tu commences par respirer l’Air. Puis à un moment tu dois te lever, il y a la conquête de la verticalité avec la conquête de la Terre, puis vient la salle d’Eau. À un certain moment de ma vie, le simple plaisir de me passer de l’eau sur le visage me semblait une raison suffisante pour exister. Enfin si tu prends ton petit-déjeuner, il faut faire réchauffer les aliments et tu utilises le Feu. J’en suis là… Il y a un philosophe disciple de Gaston Bachelard, Gilbert Durand qui a symbolisé le trajet anthropologique entre le diurne et le nocturne qui est l’espace dans lequel les formes disparaissent et c’est là que tu peux communier avec ton environnement. Il l’appelle le régime mystique. Le diurne dans lequel on distingue bien les formes, il l’appelle le régime héroïque parce qu’il faut batailler et savoir comment aborder toutes ces formes que tu perçois. Mais entre les deux, il y a les périodes intermédiaires de l’aube et du crépuscule qui font vivre un entre-deux interfaciel qu’il voit comme régime dialectique, plus ou moins synthétique[13].
VB: Penses-tu que l’opposition entre le diurne et le nocturne dans laquelle tu t’es construit tend avec l’âge à disparaitre ?
GP: Non, je pense qu’elle se renforce, l’un voulant éliminer l’autre : le diurne veut triompher en me signifiant que mes rêves et mes imaginaires n’ont été que des chimères ; ou au contraire le nocturne l’emporte, me faisant sombrer progressivement dans une confusion informe purement réflexe. L’enjeu pour moi est d’actualiser les tensions entre les deux en osant ouvrir la voie initiatique personnelle d’une résurrection dialectique quotidienne.
VB: Cet entretien et cette révélation que tu nous fais autour de toute cette partie de ta construction que tu gardais cachée jusque-là peut-elle être une manière de répondre à ce questionnement?
GP: Cet entretien est un espace d’expression extraordinaire qui nous permet d’échanger sur cette confrontation des polarités opposées et nous le faisons au début d’une matinée. Cela aurait été très différent si nous l’avions fait hier soir comme nous l’avions d’abord prévu. Il faut aussi noter que cet entretien se passe à Salvador de Bahia, la ville de tous les Saints.
VB: La disparition de Pierre Dominicé qui nous a été annoncée hier n’est pas anodine non plus.
GP: Absolument… Et cet entretien se passe en 2024, entre la Pentecôte et la Trinité, qui aura lieu dimanche prochain, tout juste soixante ans après mon courant d’air.
Fin aout 2024, en finissant la transcription de cet entretien qui avait eu lieu le 23 mai dernier et qui n’avait pas duré plus d’une heure, nous avions encore quelques questions importantes que nous voulions poser à Gaston pour compléter ce parcours de vie assez hors norme. Voici nos questions et ses réponses qu’il nous a envoyées par écrit.
Christine Delory-Momberger: Pierre Dominicé a été professeur en sciences de l’éducation à L’université de Genève et vous avez été pionniers tous deux avec Guy de Villers, professeur en psychologie à l’université de Louvain la Neuve en Belgique, de la création du courant des histoires de vie en formation. As-tu partagé avec eux cette construction très personnelle, et en particulier avec Pierre Dominicé qui avait dans une très belle autobiographie fait le récit de son engagement spirituel[14]? L’histoire que tu nous as racontée sur la survenue du courant d’air et la voie que te montrait la résurrection ne serait-elle pas en lien avec le projet de créer un domaine de recherche et de formation en sciences humaines qui montrerait comment les parcours de vie sont un long apprentissage expérientiel et comment le récit autobiographique transforme les personnes et leur ouvre la possibilité de devenir sujets de leur vie ?
Gaston Pineau: Avec ton livre Les histoires de vie : de l’invention de soi au projet de formation [15], et maintenant en tant que photographe, le travail que tu as accompli avec Le cycle mémoriel [16], tu es la personne qui incarne et explicite le mieux la parenté profonde entre ce courant émergeant des récits de mise en forme et en sens des temps et contretemps de la vie et celui plus ancien de la Bildung allemande. Cette parenté profonde est au cœur de l’émergence des histoires de vie « comme recherche et construction de sens à partir de faits temporels personnels »[17]. C’est elle qui implicitement nous a réunis, Guy de Villers, Pierre Dominicé, Bernadette Courtois, Guy Bonvalot et moi et quelques autres personnes en recherche, d’abord en réseau à Montréal en 1983, puis en Association de recherche internationale d’Histoire de vie en formation (ASIHVIF) à Paris au début des années 90. Ta venue a heureusement permis de mettre en culture explicite cette parenté de fonds.
Elle a nourri et cultivé profondément nos échanges avec nos héritages culturels différents : Pierre, protestant, Guy, psychanalyste freudien et moi catholique résurgent. Guy a été l’inspirateur premier de la Charte éthique de l’Asihvif. Pierre nous a fait plancher à Genève sur autoformation, hétéroformation et théoformation et la retraite pour moi a ouvert la hiéroformation, la formation avec le sacré. J’ai alors publié Le gai savoir de l’amour de la vie[18], un livre ponctuant ce passage à la retraite, tu y as d’ailleurs écrit le chapitre « Enjeux et paradoxes de la société biographique »[19].
La profondeur de nos échanges a suscité un passage à la retraite très créatif. Une collègue et amie, Christine Abels-Eber, a coordonné un travail collectif hétéro, co-et-autobiographique sur mon trajet de vie : Gaston Pineau : trajet d’un forgeron de la formation. Regards croisés de compagnes et compagnons de route[20]. Pierre l’a ouvert avec Portrait en quelques touches trop rapides d’un ami précieux[21]. Et Guy lui a ouvert la partie sur les histoires de vie : La vie et son récit : spécificité du récit autobiographique en formation d’adultes[22].
La mort de Pierre Dominicé a réactualisé pour moi un de ses derniers ouvrages de recyclage de la vie qu’impose de gré ou de force la retraite et auquel tu fais allusion Au risque de se dire[23]. Il m’a beaucoup aidé à oser reconnaître socialement la voie de communion intime avec des environnements socio-temporels et cosmiques beaucoup plus grands que nos minuscules vies, dans lesquels chaque nuit nous plonge. C’est comme si s’imposait l’histoire de vie à trois vitesses qu’évoque Braudel dans son ouvrage sur la vie méditerranéenne[24] : la sienne rapide, celle intergénérationnelle plus longue et celle cosmique de la nature, si lente qu’elle nous paraît immobile, alors qu’elle ponctue nos biorythmes quotidiens diurnes/nocturnes. C’est avec ces temporalités à trois vitesses que se forme notre historialité personnelle existentielle[25]. Et alors j’ai osé entreprendre d’apprendre mon quotidien d’octogénaire par une auto-écoformation avec les sept gestes matinaux déjà évoqués : comment ne pas réduire ma vie à un champ de conscience-réflexe de plus en plus étroit, mais au contraire essayer de l’élargir en le réfléchissant à la grandeur du monde ? J’ai osé afficher socialement ma voie dialectique de résurrection quotidienne qu’imposent de vivre les contradictions entre passions inassouvies de la nuit et ordres impératifs du jour. La rencontre-entretien à Salvador de Bahia avec toi et Valentin a représenté une synchronicité majeure pour m’aider à reconnaître cette voie d’insurrection contre la mort qui remonte quand même à plus de deux millénaires. Grande reconnaissance à vous deux.
VB: Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie depuis notre entretien ?
GP: Votre création du Banquet des Vivants[26] que vous m’avez racontée à Salvador de Bahia a actualisé pour moi la pertinence moderne du Charpentier de faire du repas convivial le geste fondateur d’une nouvelle geste mystique. Au dernier repas, la nuit où sa mort s’est décidée, en insurrection contre celle-ci, il s’est identifié au pain et au vin. Et il a fait de leur consommation en son souvenir, le geste transsubstantiateur transformant la mort en la naissance d’une nouvelle vie. Il a prolongé le processus alimentaire de transformation des matières minérales et végétales en chair humaine en le symbolisant en naissance d’une nouvelle vie. Et il a utilisé la remémoration comme révolution humaine et transhumaine des temps linéaires. Votre Banquet des Vivants a remémoré ce que m’a inspiré un repas anniversaire à Capharnaüm en 2009, fêtant les quarante ans d’une nouvelle alliance au Mont des Béatitudes en Galilée.
Pour saisir et être saisi par la nouveauté interloquante de cette insurrection devant la mort, il faut re-susciter le Ressuscité, le susciter à nouveau et non pas le ressusciter, c’est déjà fait et heureusement car le pouvoir nous en échappe. La résurrection ne se laisse pas localiser en un seul lieu, ni en un seul temps donné. Elle ouvre au contraire la temporalité et la spatialité à une nouvelle existence, affranchie des lois limitées et mortifères d’avant. Sans pour autant être plus précise. Elle ouvre au contraire à des relations libérantes d’un Amour inconnu et infini, créateur et générateur de vie éternelle.
Rien de moins. Mais rien de plus. Au grand désappointement de ses plus proches, le ressuscité ne restaure pas la royauté en Israël, ni ne révèle les futurs trajets de chacun. Il n’est pas ressuscité pour cela. Il leur prépare seulement le petit-déjeuner, les invite à dîner ou se laisse inviter… presque comme avant ! Alors pourquoi ressusciter ? Ses premiers compagnons ont dû longtemps s’interroger, chercher, débattre, désemparés devant cette situation nouvelle à apprendre à vivre… jusqu’à leur mort. Leurs écrits, Apocalypse compris, rendent compte de ces recherches passionnées mais tâtonnantes, pour témoigner, trouver ce qui peut susciter et re-susciter ce ressuscité.
Le ressuscité n’est pas ressuscité pour laisser passif, n’avoir rien à faire, ou le faire comme avant. Il est ressuscité pour faire participer le monde à sa résurrection, susciter en lui une vie nouvelle avec et par-delà la mort : « Tout pouvoir m’a été donné (…) Allez (…) Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu, 28,18-20). Mais en ressuscité libérateur, IL donne seulement un Esprit libérant, une Force de libération inspirant les formes à trouver et réaliser. Un seul commandement : aimer comme il a aimé. Et un geste basique pour réactualiser toujours cette présence alliée permanente : se souvenir de lui en mangeant et en buvant. Ce geste re-suscite le ressuscité.
Détacher le re n’a donc pas seulement l’intérêt de re-susciter l’attention sur le terme de résurrection qu’une utilisation bi-millénariste a pu user. Il permet de mettre en relief un simple et discret préfixe qui enracine cette opération mystérieuse dans l’activité langagière bio-cognitive courante.
Ce préfixe primaire et apparemment très pauvre pour signifier une simple reproduction automatique du même, est en fait très complexe et au cœur de la créativité vivante, « au cœur des deux chefs-d’œuvre morphogénétiques de l’organisation vivante : la reproduction d’un autre être et l’auto-production de la qualité de sujet »[27]. Le re est si riche, non seulement de répétition, mais de rétroaction, réorganisation, régénération, remémoration, réflexion, récursion que Edgar Morin en fait un indicateur/opérateur linguistique majeur d’évolution créatrice de la biosphère. « Il ne peut être seulement tourné vers le passé, car il opère circuit et échange passé/présent/avenir »[28]. Le re cyclique et spiralant est au cœur des constructions temporelles historiques, physico-cosmiques et bio-cognitives.
Le Ressuscité n’est pas seulement parachuté d’en-haut. Il vient aussi accomplir un mouvement amorcé en bas : il accomplit divinement un mouvement de vie montant et complexifiant, par reprise, remémoration transformante et transfigurante, de vie brute, de matière première en expression de « nouvelle unité opérationnelle par couplage structurel »[29]. D’où, quelle que soit leur maladresse, la nécessité de ces balbutiements « pour re-susciter en permanence ce Ressuscité, en tentant d’expliciter sa présence agissante au cours des temps et de notre histoire »[30].
Depuis votre entretien, j’essaie de transformer tout repas en geste conviviale mystique.
[3] https://photodocparis.com/LBDV-02-la-transmission-une-affaire-sensible
[4] https://www.youtube.com/watch?v=pU4pOQ_MKbQ
[5] René Voillaume. Au cœur des masses. La vie religieuse des Petits Frères du Père de Foucauld. Préface de S.E. Mgr de Provenchères, Paris, Éditions du Cerf, 1959 ; 1 vol., In-16.
[6] Pax Christi est né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, il devient en 1950 le “Mouvement catholique international pour la paix”, reconnu par l’Église catholique et aujourd’hui présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est reconnu comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) consultative auprès des institutions internationales de l’ONU et du conseil de l’Europe.
[7] Pineau Gaston (2023). « Survol de 60 ans de recherches universitaires avec les histoires de vie pour développer l’autoformation par l’institutionnalisation de fonctions d’accompagnement. » dans Christophe Niewiadomski et Hervé Prévost (dir.). Devenir sujet de sa formation. Histoires de vie et processus de subjectivation. Paris : L’Harmattan, p. 109-137
[8] Kange Fadel (2016). Transhumances interculturelles d’un arabe de Nazareth. Paris : L’Harmattan
[9] L’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
[10] Gaston Pineau (2012). Rendez-vous en Galilée. Journal de voyage à vélo Tours-Galilée. Paris : L’Harmattan.
[11] Gaston Pineau (2019). Voyages, retraite et autoformation mondialogante. Paris : L’Harmattan.
[12] Gaston Pineau (2024). Apprendre le quotidien en octogénaire. S’auto-écoformer avec les gestes matinaux. Paris : L’Harmattan.
[13] Durand Gilbert (1969). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Dunod
[14] Pierre Dominicé (2015). Au risque de se dire. Paris : Téraèdre.
[15] Christine Delory-Momberger (1ère édition 2000,2ème édition 2004). Les histoires de vie. De l’invention de soi au projet de formation. Paris : Anthropos.
[16] Le cycle mémoriel est un travail photographique au long cours de Christine Delory-Momberger générée par une quête existentielle sur sa filiation familiale. Ne pouvant trouver appui dans une transmission généalogique, c’est dans l’imaginaire et la création artistique qu’elle est allée pour se construire une forme qui la délivrerait de l’oubli. Peu à peu une histoire familiale sur quatre générations s’est construite, marquée par les migrations à travers l’Europe, les guerres, la violence, l’exil. Des thèmes ont tissé l’histoire : l’enfance, la filiation intergénérationnelle, l’empreinte de la grande Histoire. L’œuvre rassemble cinq ouvrages parus aux éditions Arnaud Bizalion : EXILS/REMINISCENCES (2019), En s’enfonçant dans la forêt (2021), Lune noire (2023), L’entaille de l’exil (2025) et un leporello L’album imaginaire ou la famille retrouvée (2022).
[17] Gaston Pineau & Jean-Louis Le Grand (2019). Les histoires de vie. Paris : Que sais-je ?, p.3.
[18] Gaston Pineau (2009). Le gai savoir de l’amour de la vie. Dans Bachelart Dominique et Pineau Gaston, dir. (2009). Le biographique, la réflexivité et les temporalités. Articuler langues, cultures et formation. Paris : L’Harmattan.p.171-184
[19] Christine Delory-Momberger (2009). Enjeux et paradoxes de la société biographique. Dans Bachelart Dominique et Pineau Gaston, dir. (2009). Le biographique, la réflexivité et les temporalités. Articuler langues, cultures et formation.Paris : L’Harmattan Paris : L’Harmattan, pp. 75-87
[20] Christine Abels-Eber, (2010). Gaston Pineau : trajet d’un forgeron de la formation. Regards croisés de compagnes et compagnons de route. Paris : L’Harmattan.
[21]Christine Abels-Eber, (2010). Gaston Pineau : trajet d’un forgeron de la formation. Regards croisés de compagnes et compagnons de route. Paris : L’Harmattan, p.19-25.
[22] Christine Abels-Eber (2010). Ibidem, p.119-127.
[23] Pierre Dominicé (2015). Au risque de se dire. Paris : Téraèdre.
[24] Fernand Braudel (1949). La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris : A. Colin
[25] Gaston Pineau & Jean-Louis Le Grand (2019). Les histoires de vie. Paris : Que sais-je ? p.87-90.
[26] https://photodocparis.com/le-banquet-des-vivants
[27] Edgar Morin (1980). La méthode, tome 2 : La Vie de la vie. Paris : Seuil. p.346.
[28] Edgat Morin (1980). Ibidem.
[29] Francisco Varela (1989). Autonomie et Connaissance. Essai sur le vivant. Paris : Seuil.
[30] Gaston Pineau (2012). Rendez-vous en Galilée. Journal de voyage à vélo Tours-Galilée. Paris : L’Harmattan.. p. 176-177

